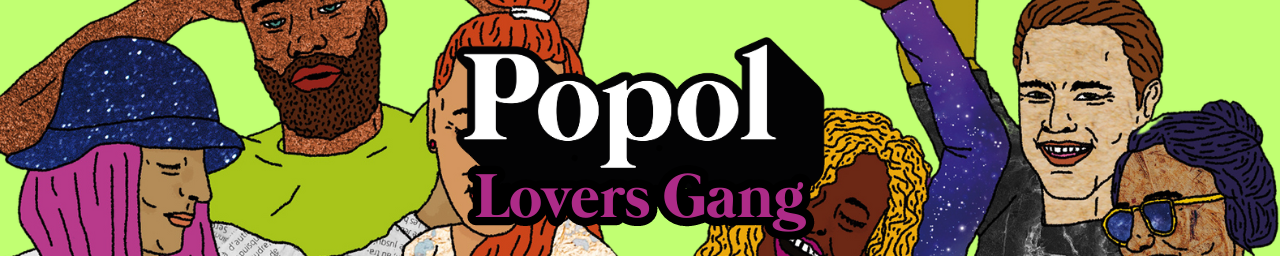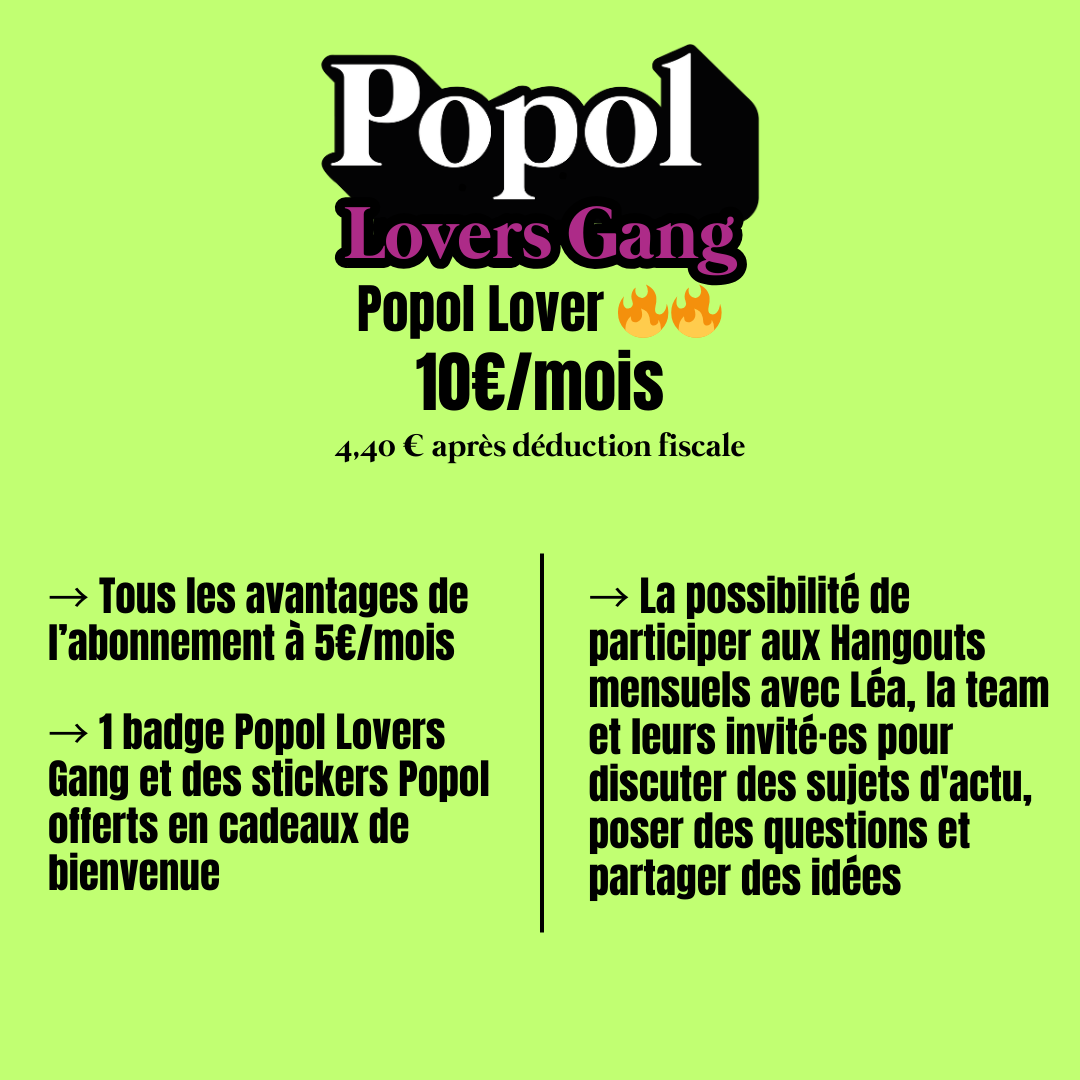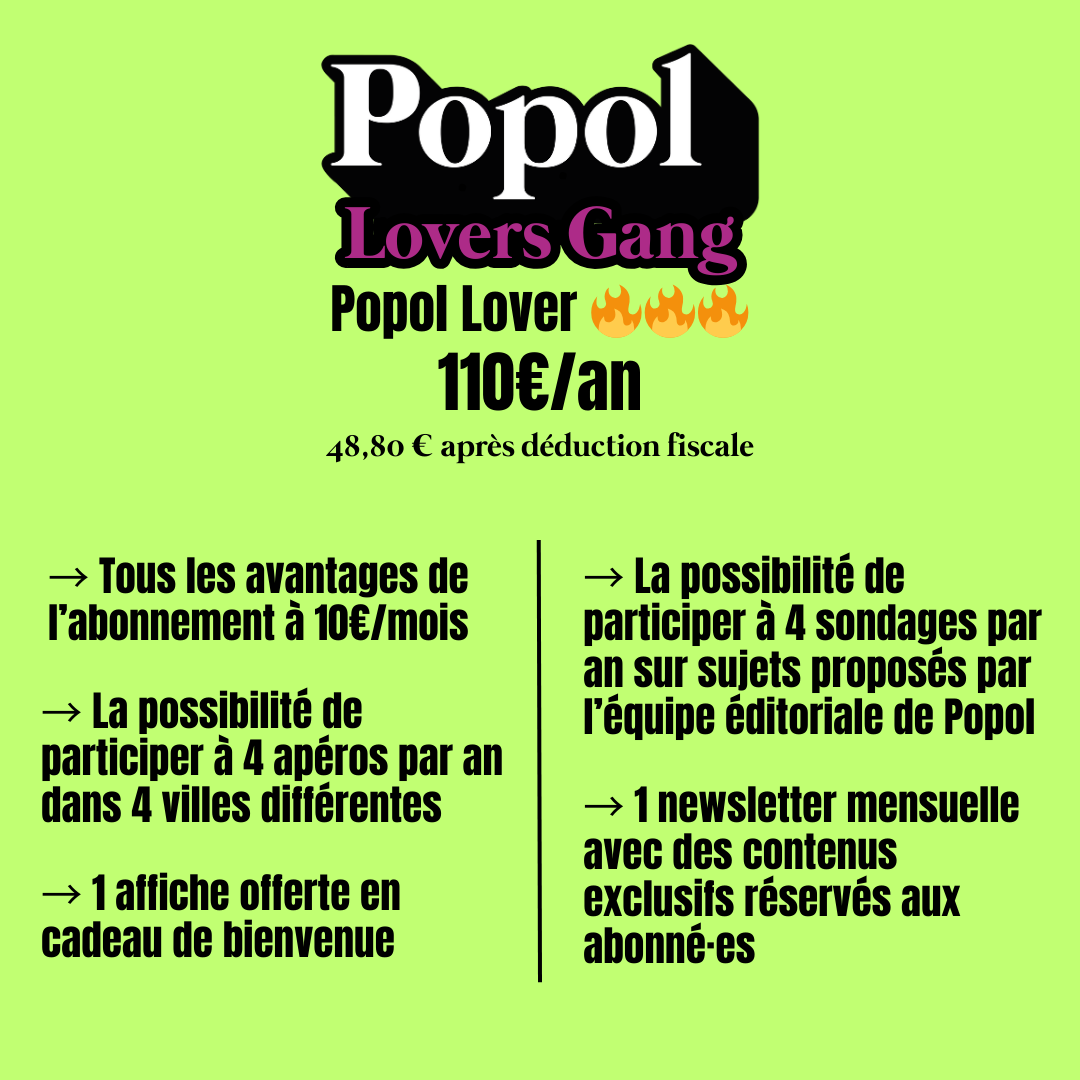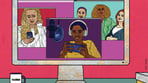Popol Post
"No one is illegal", "Femmes, vie, liberté", entretien avec Sharareh Mehboudi et Live "féminismes et littérature"


No one is illegal
Renée Nicole Good avait 37 ans, elle vivait dans le Minnesota et, le 7 janvier 2026, elle a été abattue en pleine rue par un agent de l’ICE, l’agence fédérale des douanes et de l’immigration aux Etats-Unis. Cet assassinat, largement documenté, a déclenché des manifestations massives dans plusieurs villes du pays.
La mort de Renée Good survient dans un contexte où l’ICE est accusée depuis des années d’excès de pouvoir et de dérive sécuritaire. L’agence opère comme une police fédérale parallèle, dotée d’armes, de centres de détention, de pouvoirs d’arrestation, et d’une culture institutionnelle marquée par l’opacité et les violences.
Là encore, les femmes paient un prix particulier. The Intercept a révélé en 2018 que plus de 1 200 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées contre des agents d’ICE entre 2010 et 2017, dont l’immense majorité n’a abouti à aucune sanction. De nombreuses ONG ont dénoncé les conditions dangereuses imposées à des femmes enceintes en détention, privées parfois de soins essentiels ou placées en isolement. Et en 2020, un scandale a éclaté lorsqu’une infirmière lanceuse d’alerte a révélé des cas de stérilisation forcée dans un centre ICE de Géorgie.
Même si Renée Nicole Good n’était pas en situation de migration, elle a été tuée par une agence dont les méthodes sont historiquement dirigées contre les personnes migrantes, en particulier les personnes non blanches et en situation de vulnérabilité. Son assassinat rappelle que la violence migratoire est partout.
Le slogan “No one is illegal”, massivement scandé dans les marches qui ont suivi sa mort, prend alors une dimension nouvelle. Il ne s’agit pas seulement de rappeler que personne ne devrait être réduit à un statut juridique. Il s’agit de dénoncer un appareil d’État devenu si puissant, si armé, si peu contrôlé, qu’il tue sans impunité. Ce slogan devient un diagnostic féministe : ce ne sont pas les individus qui sont “illégaux”, ce sont les systèmes de domination qui fabriquent l’illégitimité pour mieux la réprimer.
Rendre femmage à Renée Nicole Good, c’est saluer la mémoire d’une femme qui n’aurait jamais dû mourir ainsi, mais aussi de tout·es celles et ceux dont les noms se perdent dans les angles morts des politiques migratoires. Les disparu·es, les personnes enfermées dans des centres de rétention, les travailleuses domestiques menacées d’expulsion, les mères et pères séparé·es de leurs enfants à la frontière... Ce continuum de violence n’a rien d’abstrait : il est administratif, policier, politique.
Alors oui le nom de Renée Nicole Good doit rester à jamais dans notre mémoire afin de dire que la frontière tue, même lorsqu’il n’y en a pas. Mais aussi afin d’affirmer que tant que des agences étatiques armées pourront abattre des civil·es, nous aurons le devoir de répéter, encore et encore que personne n’est illégal·e.
Iran : Femme, vie, liberté
Trois ans après les révoltes qui avaient suivi la mort de Mahsa Amini, battue à mort pour un foulard mal positionné sur ses cheveux, les Iraniennes et les Iraniens se révoltent à nouveau contre le régime autoritaire de Ali Khamenei. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour faire tomber les mollahs ?
En ce début 2026, la révolte est cette fois-ci partie des bazars, où l’hyper inflation et la dévaluation du rial a accentué une crise économique majeure. D’abord centralisée à Téhéran, la révolte a fini par contaminer toutes les provinces et comme pour les manifestations de 2022 qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, celle de 2018 et toutes les autres tentatives de faire entendre des voix dissidentes, la répression est sanglante et il est d’ailleurs difficile d’en prendre la mesure puisque le gouvernement iranien a décrété un black-out internet total, coupant les Iraniennes et les Iraniens du reste du monde.
En 2022, après la mort de Mahsa Amini, les contestataires étaient majoritairement des jeunes et des femmes qui manifestaient au son de « Femme, vie, liberté » et luttaient contre ce que les féministes iraniennes appellent une « apartheid de genre », c’est-à-dire les discriminations économiques, juridiques et culturelles dont les femmes iraniennes souffrent. L’obligation de porter le voile étant un des symptômes d’une lutte bien plus profonde et collective suscitant de nombreux malentendus dans les pays occidentaux qui usent du sort des femmes iraniennes pour servir des arguments qui non contents de friser l’islamophobie n’aident en rien les Iraniennes et les Iraniens dans leurs luttes dont on sait qu’elles sont extrêmement organisées, politisées et courageuses, et qui nous alertent toutes et tous sur l’endurance qu’il faut parfois pour faire la révolution, les échecs, les retours de bâtons et au final, n’avoir même pas la certitude que si victoire il y a, elle nous sera pas confisquée.
Il y a évidemment beaucoup à apprendre du courage des Iraniens et des Iraniennes, mais ce que nous enseigne cette nouvelle poussée de révolte, malgré les tentatives de récupération et de division, c’est que le féminisme quand il s’inscrit dans l’intersectionnalité a une capacité à fédérer dans un même mouvement, une société où, par essence, tout le monde n’a pas les mêmes intérêts, ni les mêmes idéologies.
Ainsi « femme, vie, liberté » n’est pas seulement le slogan des femmes, mais celui de tout un peuple qui se soulève, dans les grandes villes, dans les campagnes, dans les universités mais aussi dans les marchés.
Saluons leur courage… et prenons-en peut-être aussi un peu de la graine !
“Le régime iranien fait face à une menace existentielle” - entretien avec Sharareh Mehboudi
Pour ce 70è numéro, Popol a pu s’entretenir avec Sharareh Mehboudi journaliste iranienne activiste et militante féministe réfugiée. Elle a été contrainte de quitter l’Iran en 2019 et nous confie son sentiment face au tournant historique que vit le pays. Voici un extrait de l’interview à retrouver en intégralité sur Popol Media.
Propos recueillis par Clothilde Le Coz
Assistons-nous à une révolution que les autorités tentent de dissimuler ?
Ce n’est plus un simple rassemblement ni une vague de protestation de courte durée : nous sommes face à l’un des mouvements contestataires les plus vastes et les plus sérieux en Iran depuis la révolution de 1979, et de nombreux analystes y voient un tournant historique présentant les caractéristiques d’une transition révolutionnaire.
Oui, à mon sens, ce qui se déroule aujourd’hui en Iran dépasse, sur de nombreux plans, le stade d’une contestation ponctuelle et prend la forme d’un mouvement aux caractéristiques révolutionnaires : extension géographique, continuité, montée d’une forme d’organisation, radicalisation des slogans et surtout passage clair de la revendication à un rejet total du système.
Le pouvoir, précisément pour cette raison, tente de dissimuler cette réalité. Son instrument principal est le blackout informationnel : coupure d’Internet, restrictions sur la téléphonie et les communications, blocage de la circulation des images et des informations, et parallèlement construction d’un récit officiel qui présente les manifestants comme des « émeutiers » ou des « agents étrangers ». C’est exactement ce qui s’est produit en 2019 : d’abord la coupure des communications avec le monde, ensuite la répression massive dans l’obscurité.
À mes yeux, lorsqu’un régime, au lieu d’apporter une réponse politique, recourt à une coupure nationale des communications et à une répression de type militaire, cela signifie qu’il ne fait pas face à une crise ordinaire ; il fait face à une menace existentielle — et c’est précisément ce que nous voyons aujourd’hui en Iran.
Peux-tu expliquer ce qui est en train de se dérouler ?
À mon avis, la faim et la pression économique sont clairement l’un des moteurs principaux de ce soulèvement : les Iranien·nes vivent depuis des années sous le poids de l’inflation, de l’effondrement des conditions de vie et de la disparition de tout espoir. Je pense toutefois que réduire ces protestations à l’économie est une erreur d’analyse.
Cette fois, nous faisons face à un mécontentement plus large, à un désespoir plus total et à une volonté d’en finir avec l’ensemble du système. Lorsque des messages et des appels, jusque dans des villages et des zones éloignées, invitent les habitants à rejoindre les centres urbains pour participer aux manifestations, il ne s’agit plus uniquement d’économie. Le pouvoir a même tenté de convaincre la population de ne pas descendre dans la rue en distribuant de l’aide (bons de consommation, argent), mais certains m’ont dit clairement : « Pour nous, le problème, c’est la totalité de ce système… nous voulons qu’ils partent. Nous sommes descendus dans la rue et nous ne rentrerons pas tant que le régime ne sera pas tombé. »
L’échec du pouvoir dans tous les domaines a fait disparaître l’espoir de réformes. C’est pourquoi des gens sont descendus mains nues dans la rue et se sont retrouvés face à un régime armé jusqu’aux dents.
Dans un post publié le 12 janvier 2026 sur Instagram, tu parles de « censure douce » des médias occidentaux face à la situation actuelle en Iran. Peux-tu expliquer cette expression ?
À mes yeux, l’un des aspects les plus douloureux de cette crise n’est pas uniquement la répression dans les rues d’Iran, mais aussi la manière dont elle est relayée dans une partie des médias occidentaux, notamment en France. Aux côtés de médias et de journalistes professionnel·le·s qui font preuve d’empathie et de rigueur, nous constatons aussi une forme de silence, de minimisation ou de narration sélective.
Quand je parle de « censure douce », je ne parle pas d’une censure officielle. Je parle d’un mécanisme indirect : une partie du paysage médiatique analyse ce soulèvement non pas à partir de la réalité du terrain et de son coût humain, mais à travers le prisme de préférences politiques et de cadres idéologiques. Résultat : au lieu de se concentrer sur l’essentiel — les morts, les arrestations massives, la menace d’exécutions et le blackout informationnel — l’attention se déplace vers des débats politiques, voire vers les slogans des manifestants, que certains courants tentent de récupérer en fonction de leurs intérêts.
D’un point de vue éthique, dans un moment pareil, la question n’est pas de savoir quelle force politique nous préférons. La question est qu’un peuple subit une répression sanglante et que sa voix est étouffée dans l’obscurité. Les droits humains et la liberté d’un peuple ne doivent pas dépendre des préférences politiques de certains analystes ou médias.
En tant que journaliste, témoin de la situation actuelle en Iran, comment vérifies-tu tes informations dans un contexte où l’accès à l’information est limité ?
La vérification de l’information en Iran — notamment dans ce contexte de coupure d’Internet et de censure — est l’un des aspects les plus difficiles du travail journalistique. Mais je m’appuie sur mon expérience vécue en Iran — en particulier celle de novembre 2019 — ainsi que sur un réseau de sources humaines fiables dans différentes villes, et sur une collecte d’informations en plusieurs couches.
Ma méthode est de ne jamais publier une affirmation majeure sur la base d’une seule source. Toute information doit être confirmée par plusieurs canaux indépendants : témoins directs, citoyen-journalistes, sources locales, et parfois contacts au sein du milieu médical ou des familles. En parallèle, je vérifie les images et vidéos via des indices de lieu, de temporalité et leur cohérence avec d’autres récits, afin d’établir qu’elles sont authentiques et liées aux mêmes événements.
Enfin, étant donné que la coupure d’Internet limite la vérification indépendante, je traite les chiffres avec prudence et je distingue toujours clairement les chiffres « confirmés » des chiffres « estimés ». Pour moi, l’essentiel est la précision et la responsabilité professionnelle, pas la vitesse ni l’émotion.
Retrouvez bientôt l’interview en intégralité sur notre site Internet : popol-media.com
À faire
Littérature & Féminismes – 20 janvier 2026, 19h30 · Point Éphémère
Pour bien commencer l’année, Popol vous invite à une soirée où les livres deviennent des terrains de lutte, des outils de résistance et des espaces pour réinventer nos récits. Léa Chamboncel échangera avec Camille Dumat, Annabelle Chauvet & Juliette Debrix (Un livre, une tasse de thé) et Deli (Overbookées) pour explorer ce que la littérature fait aux féminismes — et ce que les féminismes font à la littérature. On parlera d’autrices qui ont dû écrire contre, de récits qui dérangent, de pages qui ouvrent des brèches dans l’ordre établi. Un moment pour réfléchir, débattre, vibrer… et peut-être repartir avec l’envie urgente d’écrire, de lire, ou de réécrire le monde. Entrée libre sur réservation.