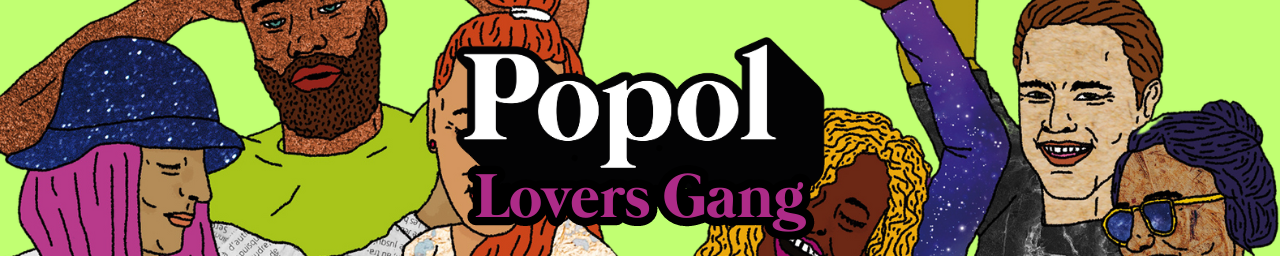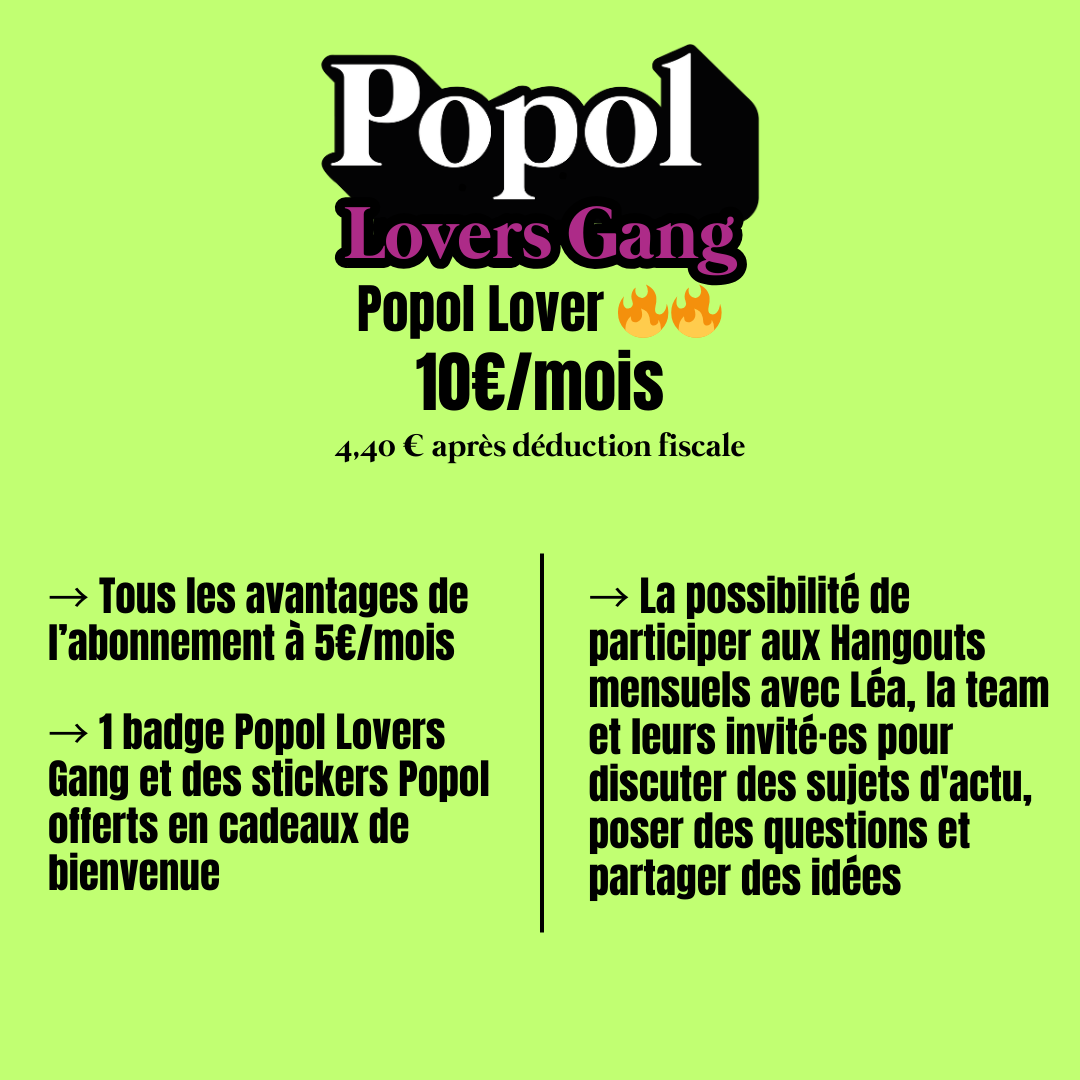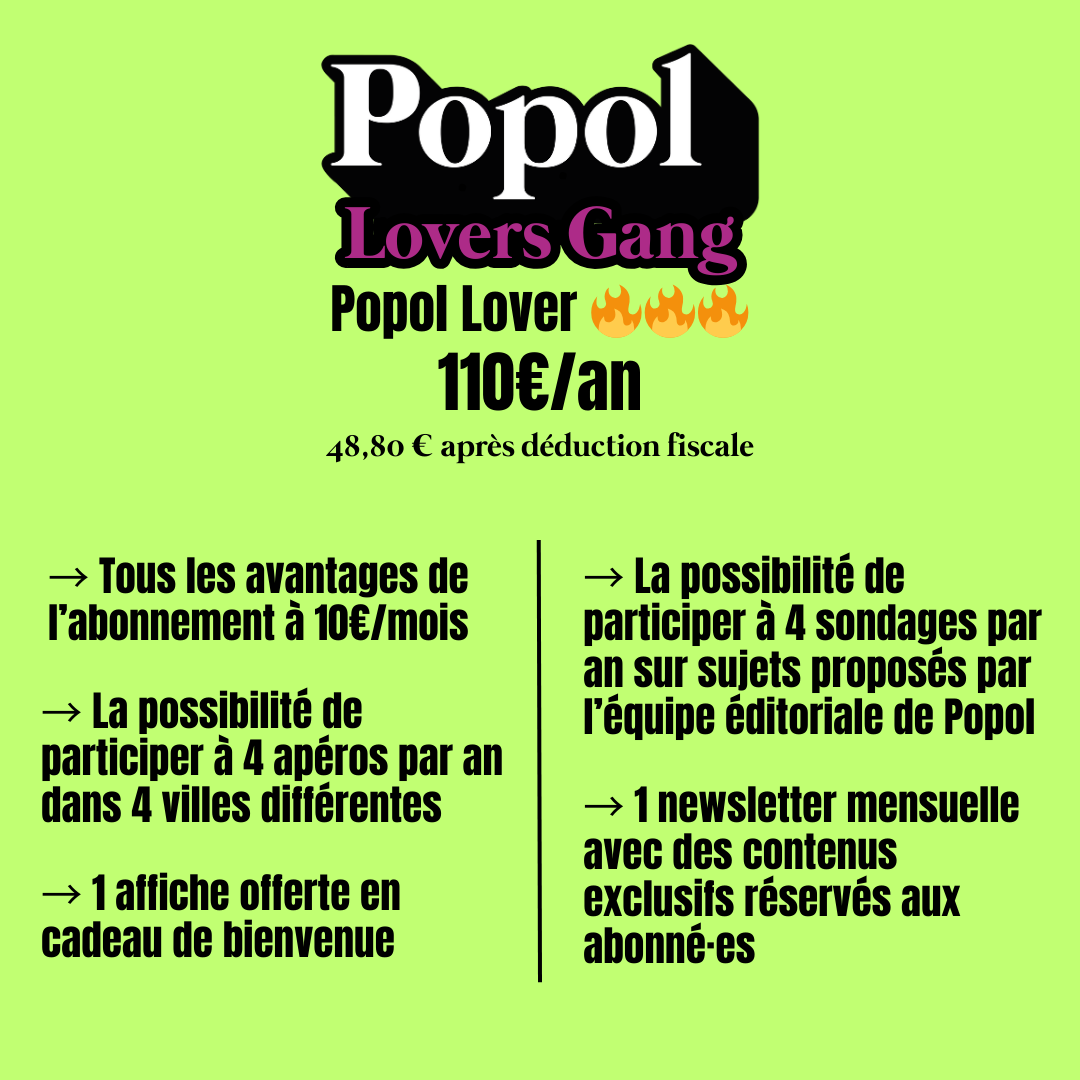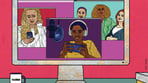Popol Post
Parité sociale, solitude, tradwifes & écologie, situation à Madagascar, etc.


La parité sociale, une urgence démocratique (et féministe)
Et si la parité sociale était la grande idée oubliée du débat démocratique ? À force de parler de crise de la représentation, d’abstention et de “déconnexion des élites”, on en oublie un détail essentiel : notre classe politique n’est pas seulement masculine, elle est aussi (et surtout) socialement homogène. Pour résumer, on peut dire qu’elle est riche, diplômée, et coupée de la réalité.
Selon le rapport “Tous les mêmes ? Portrait social de la France politique de 2002 à nos jours” publié par le collectif Démocratiser la politique (DLP), créé il y a trois ans, 87 % des eurodéputé·es français·es élu·es en 2024 appartiennent aux classes supérieures. À l’Assemblée nationale, les député·es issu·es des catégories populaires ne représentent que 6 % des élu·es, contre 2 % en 2012. Et si l’on continue à ce rythme, il faudrait attendre 2096 pour atteindre une représentation équilibrée entre classes sociales.
Autrement dit, la démocratie française fonctionne avec une moitié de la population absente de la table des décisions. Et pourtant, les Français·es issu·es des classes populaires ne sont pas désintéressé·es de la politique. Au contraire, comme nous l’apprend le rapport de DLP, 1,4 million de personnes issues des milieux ouvriers ou employés se sont portées candidates à au moins une élection depuis 2002, soit la moitié de l’ensemble des candidatures. Le problème, ce n’est donc pas la prétendue “apathie” populaire, mais un système d’exclusion structurelle nourrie par tout un tas de freins : manque d’accès au financement, absence de réseaux, candidatures reléguées en bas de liste, mépris social bien ancré, etc.
C’est là qu’entre en jeu la proposition du collectif : la parité sociale. Inspirée de la parité femmes-hommes instaurée par la loi du 6 juin 2000, elle viserait à imposer aux partis politiques de présenter un quota de candidat·es reflétant la composition sociale réelle du pays. Pas seulement un symbole : une révolution structurelle, qui ferait de la politique un miroir de la société plutôt qu’une oligarchie déguisée en démocratie défectueuse.
Parce que oui, parler de parité sociale, c’est parler de pouvoir. C’est questionner qui décide pour qui, et au nom de quoi et de qui. C’est se demander pourquoi les décisions publiques sont prises majoritairement par des cadres supérieurs, et si cette uniformité n’explique pas, au moins en partie, le fossé entre le pays et ses dirigeants. Et quand les mêmes profils monopolisent les sièges des enceintes décisionnaires, c’est toute l’intelligence collective qui s’appauvrit.
Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si les femmes des classes populaires restent les grandes oubliées de la parité actuelle. La loi de 2000 a certes permis d’accroître le nombre de femmes élues, mais elle n’a ni brisé le plafond de verre social, ni empêché la reproduction des élites. Les femmes élues sont très majoritairement issues des milieux favorisés. Or, la parité de genre sans parité sociale, c’est un progrès de façade, les visages changent, mais les rapports de pouvoir restent les mêmes. Le rapport Démocratiser la politique le note d’ailleurs, bien que “les femmes appartiennent moins souvent aux classes supérieures que leurs homologues masculins” (p. 53), la part des femmes issues des classes populaires dans les assemblées reste marginale.
Et quand on voit que même la parité de genre recule (36,4 % de femmes à l’Assemblée nationale en 2024 contre 38,7 % en 2017), on comprend l’urgence d’inventer de nouveaux mécanismes “anti-backlash” pour éviter que les acquis ne s’effritent à chaque élection.
La parité sociale n’est pas qu’un concept théorique, c’est une réponse politique à la crise de représentation que nous traversons. Elle peut s'appuyer sur des leviers très concrets (des contrats de mandature assortis d’objectifs de diversité sur deux scrutins successifs, ou encore des conventions citoyennes décisionnelles tirées au sort, où la composition sociale serait réellement représentative du pays). En somme, il s’agit d’une manière de rendre enfin la parole à celles et ceux qu’on maintient d’ordinaire à distance du pouvoir.
Et si c’était l’une des rares issues possibles à l’impasse démocratique actuelle ? La parité sociale ne résoudra pas tout, mais elle pourrait au moins rebattre les cartes, faire entrer dans les institutions des voix qu’on a trop longtemps confinées aux marges, celles des travailleureuses, des précaires, des invisibles.
Parce qu’à la fin, il ne s’agit pas seulement d’équilibrer des chiffres, mais de transformer la manière dont on pense la démocratie, non pas comme une aristocratie élective, mais comme un espace de partage du pouvoir et d’action collective.
Et si la prochaine grande loi de parité n’était pas genrée, mais sociale ?
Les femmes et la solitude
En cette rentrée littéraire, la question de la solitude féminine revient sur le devant de la scène. Il y a bien sûr Enfin seule de Lauren Bastide publié aux Editions Allary, mais aussi un grand retour de la femme sans enfant avec Elles vont finir seules avec leur chat de Charlotte Debest, entres autres. Ce n’est pas la première fois que la célibataire pointe le bout de son nez, dans le grand chambardement de la fameuse révolution amoureuse, sa petite silhouette revient souvent, image longtemps repoussoir devenue soudain désirable… A la seule et unique condition qu’elle ne s’incarne qu’en une seule version : celle de la femme heureuse, dégourdie, sexuellement active, entourée d’une ribambelle d’ami.es, créative, prosélyte… Ou comment le stéréotype remplace le stéréotype, fut-il bien plus sexy et facile à endosser.
Le discours sur le célibat positif qui se déploie ces dernières années se nourrit de la ringardisation de la matrimonialité, de l’entrée fracassante des femmes sur le marché du travail et de la déflagration metoo et le fameux hétérofatalisme qui voit les femmes renoncer (dans une certaine mesure) au couple. Il n’est donc pas si rare dans les milieux féministes éditoriaux de voir des jeunes femmes s’emparer de l’image de la vieille fille, alors même qu’elles sont en couple ou désireuse de l’être mais d’une manière revampée, plus fun, plus iconoclaste bien sûr. Il est évident que cette dimension enviable du célibat n’est pas seulement une mode, ni une pose, et que dans l’inconfort étroit d’un lien assigné, hétérosexuel, certaines femmes aspirent à autre chose. La liberté et la sécurité que suggère le célibat devient alors quelque chose de puissamment désirable.
Mais ce que cela signifie que de vivre seule, vraiment seule. De la différence que ça fait d’être seule à 25 ans ou à 60, de l’être à Paris ou dans la banlieue de Limoges, de l’être quand tous vos am·eis sont déjà marié·es, de l’être parce que vous n’avez pas les moyens géographiques et financiers de ne plus l’être, de ces vies-là, quel que soit leur terreau, on continue de pas savoir grand chose.
La question s’embourbe alors dans des considérations lifestyle à la limite de l’indigence. Dans les articles et le podcast consacrés au sujet, la célibataire aspire à vivre au calme, à n’« avoir de compte à rendre à personne », de « faire ce qui lui plaît » etc. Dans un article du ELLE de septembre 2023 consacré à la hausse du nombre de femmes qui déclarent ne pas vouloir d’enfant, l’aspirante nullipare (le panel portait sur des femmes de 19 à 40 ans, on peut légitimement en déduire que nombre d’entre elles auront la possibilité et le droit de changer d’avis) apparaît comme une femme carriériste, qui aime faire la fête, voyager et, surtout, qui supporte assez mal de sacrifier ses heures de sommeil. Nous sommes suffisamment familière des stratégies dialectiques que les femmes seules et sans enfants doivent déployer pour contrer la pression qui pèse sur elle, plus ou moins passive, plus ou moins agressive, pour savoir ce qui pousse une femme à parler de ses grasses matinées et de la joie de pouvoir prendre un billet pour le Caire sur un coup de tête. Cet argument-là est plus inoffensif que celui consistant à faire remarquer qu’après des siècles de lutte, le féminisme n’arrive toujours pas à faire émerger de nouveaux modèles.
On entend peu le discours discordant de celles qui vivent la chose très mal, celles pour qui c’est une vraie souffrance, celles qui ont honte, celles qui luttent tous les jours, celles qui sont en deuil, celles qui sont vieilles. De la même manière qu’autrefois la célibataire type était une vieille fille aigrie, forcément frustrée, une sorcière menaçant la société par sa seule présence, la célibataire d’aujourd’hui, telle que vantée dans les médias, les essais et les podcasts, est une femme, jeune, le plus souvent, et dynamique dont la mission est sinon de faire des émules du moins de convaincre le chaland que la vie en solo est une bénédiction. Le féminisme a raté le coche du célibat en même temps qu’il trébuche sur la marche de l’intersectionnalité : en se concentrant uniquement sur ce qu’un groupe (de femmes) a en commun, à savoir la solitude résidentielle, sans tenir compte des diversités de situation, le combat ne servira toujours que celles qui sont le plus privilégiées. Dans la sphère de l’intime, le grand Autre, pour ne pas dire l’ennemi, reste l’homme et cela tend à occulter totalement le fait que toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne. Comme l’écrit Christelle Murhula dans son essai Amours silenciées : « On oublie qu’il existe également des disparités entre les femmes. Non seulement ces disparités montrent que les femmes n’ont pas un rapport égalitaire à l’amour et à son marché, mais de plus, elles poussent certaines à embrasser des schémas amoureux qui ne leur conviennent pas, voire qui leur sont dangereux. »
Si on lutte efficacement contre les clichés grotesques de la vieille fille balzacienne, si le stigmate semble s’estomper, les destins continuent de ne pas s’incarner, ou alors encore à travers des images purement symboliques : les sorcières, les pionnières, rôle modèle inatteignables, des héroïnes de livre ou de séries… On voit fleurir des vidéos instagram de femmes riches et célèbres qui, face caméra, vantent les mérites du célibat et d’une vie sans enfant. Sur l’une d’elle, Tracee Ellis Ross, la fille de Diana Ross, quinquagénaire flamboyante et richissime, évoque son célibat, comme un mantra, elle répète “I do not believe that my life is unworthy because i don’t have a child. I do not believe that my life is unworthy because I don’t have a man in my live. But I do believe that I mother all over the place”. Comment ne pas reconnaître l’importance de ces vidéos ? Mais d’un autre côté, elles sont aussi bouleversantes et terrifiantes. Derrière l’affirmation de soi nécessaire, c’est la même torture atroce : régulièrement, au fil des ans et au gré des évolutions de notre société, la femme célibataire est appelée en place publique et, telle l’ourse qui danse au son d’un tambourin, elle est obligée de se justifier, d’expliquer son existence, de persuader tout un chacun qu’elle ne moisit pas dans la salle d’attente de la vie. Comme s’il lui revenait à elle de rassurer les bonnes gens. Ces discours sont d’autant plus durs qu’ils sont toujours le fait de femmes qui peuvent offrir au monde en échange de l’affligeant spectacle de leur isolement, des livres écrits, des films réalisés, des sommets escaladés, des mers traversées. Et c’est exactement ce que fait Tracee Ellis Ross dans un de ses Ted Talk : elle soulève l’ironie qui consiste à dire que sa nulliparité la rend inutile au moment même où sort sa cinquième série télé. Mais alors ? Quel sort réserver à celles qui n’écrivent pas ? Celles qui sont sans qualités ? Celles qui n’ont pas d’argent ? Celles qui ne peuvent pas brandir l’étendard de l’amitié en guise de totem d’immunité ? Celles qui ont trop à faire pour, en plus, devoir justifier de leurs existences.
Ces images valorisantes et nécessaires, arrangeantes au mieux, nous aident à adoucir nos contradictions, mais elles ont autant d’efficacité politique qu’une fleur plantée dans un fusil. C’est comme si le sujet tournait sur lui-même, dans un éternel renouvellement, chaque jeune femme ayant l’impression, années après années, génération après génération, d’être la première à poser les pieds sur la lune, sans voir le petit campement chaleureux où elle pourrait venir se reposer après un bien long voyage dans l’apesanteur sociale.
Et finalement c’est bien cette difficulté à se faire voir et à se faire comprendre qui lient ces expériences si différentes soient-elles, - jeunes et vieilles, ouvrières et bourgeoises, blanches et racisées - , et que l’on peut réunir sous le terme de « femmes seules ». Ces existences recèlent au moins un point commun : elles contredisent les attentes, et cette déviation, qu’elle soit subie, revendiquée, à peine pensée, continue de soulever malentendu, méchanceté et mécompréhension alors même qu’elles ont une immense utilité sociale, économique et politique.
Les tradwives sont-elles les nouvelles écolos ?
Les « tradwives » ou en français « femmes au foyer » ont commencé à faire le buzz sur Internet en 2020, alors que les gens cherchaient à trouver du plaisir et du réconfort dans les tâches ménagères les plus insignifiantes dans la période de confinement. Le hashtag #tradwife compte aujourd’hui plus de 600 millions de vues sur TikTok.
Bien qu'il n'existe pas de définition unique du terme « tradwife », toutes ont un point commun : elles transmettent un message à leurs abonnées que la vie est plus simple et moins stressante dans un mode de vie où la femme est dévouée à son mari, à ses enfants et au soin de son foyer. La vie est meilleure lorsque les femmes adhèrent aux rôles de genre « traditionnels » et se consacrent parfaitement aux tâches ménagères. Dans cette notion, il y a une envie féminine de prendre soin de son mari et de lui préparer à manger tout le temps. Par-dessus tout, les tradwives prônent l'autosuffisance. Dans une version plus rurale, les tradwives vont promouvoir un retour à une vie plus simple, un retour à la terre, à la nature : nourrir les cochons, faire son pain au levain, et sa mozzarella maison, l’instruction à la maison pour les enfants… Une vie de simplicité qui nous est présenté comme une possible porte de sortie du système capitaliste, en décalage avec les rationalités néolibérales.
Les tradwives seraient-elles alors les nouvelles militantes à la pointe des luttes anti-capitalistes, promouvant la slow life et l’écologie ? Car ces notions sont partagées avec les pensées écologistes.
Elles sont locavores, rejettent les produits transformés, sont pour le fait maison, l'upcycling, etc. En réalité, les tradwives proposent une surtout une solution fondamentalement conservatrice et individuelle à un échec sociétal : se replier non seulement sur la sphère domestique, mais aussi sur l'histoire. D’après The Guardian[1], à l'aide d'une iconographie idéalisant le passé, elles évoquent le fantasme économique et émotionnel selon lequel les familles, et en particulier les femmes, peuvent se soustraire à la complexité de la société moderne. Il serait agréable de pouvoir choisir de vivre avec un seul revenu ou de pouvoir choisir de rester à la maison et d'élever ses enfants, plutôt que d'y être contraint parce que les frais de garde sont tellement élevés.
C’est là où la comparaison avec les écologistes n’est plus valable. Ce modèle de vie traditionnel révèle une autre idéologie qui est celle de l’extrême droite, de l’antiféminisme et de l'écofascime. L'un des signes révélateurs de la montée de la propagande d'extrême droite est le désir croissant de revenir à une cellule familiale nucléaire et genrée, car ce mode de vie normalise et autorise la hiérarchie. Dans son livre « How Fascism Works », l'écrivain américain Jason Stanley affirme : « En représentant le passé de la nation comme une structure familiale patriarcale, la politique fasciste relie la nostalgie à une structure autoritaire hiérarchique centrale, qui trouve sa représentation la plus pure dans ces normes ». La Déferlante[2], revue féministe française, explique que le libéralisme politique est accusé de piétiner les normes sociales traditionnelles de la même manière que le libéralisme économique détruit l’environnement. Dans ce sillage, des mouvements identitaires établissent aujourd’hui des parallèles entre désastres climatiques et montée des luttes féministes, queers ou antiracistes.
En France, le modèle de la tradwife est nouvellement propagé par Thaïs d’Escufon, militante d’extrême droite, antiféministe et ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Comme outre-atlantique, beaucoup des portes-paroles des ce mouvements sont associées à l’aile droite américaine.
[1] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/ng-interactive/2024/jul/24/tradwives-tiktok-women-gender-roles
[2] https://revueladeferlante.fr/glossaire/ecofascisme/
Que se passe-t-il à Madagascar ?
Depuis le 25 septembre, le mouvement de la GenZ manifeste à Madagascar contre les pénuries d’eau et d’électricité menant à l’accession au pouvoir d’une unité d’élite de l’armée. On fait le point.
Les manifestations organisées en septembre ont rapidement évolué en une contestation plus large du pouvoir en place. Le mouvement est organisé par des étudiant·es et jeunes citoyen·nes de la génération Z, qui se présentent sous le pavillon de Luffy et son équipage, des Pirates au Chapeau de Paille issu de la série d'animation japonaise One Piece, le manga le plus vendu au monde et devenu le symbole de rébellion et de justice face à un pouvoir central corrompu et monopolistique.
Aujourd’hui, on dénombre au moins 400 blessés et 22 mort·es, chiffres encore contestés par les autorités.
Madagascar figure parmi les 40 États les plus corrompus au monde selon l’indice de perception de la corruption de l’ONG Transparency International. La Grande Île est aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres au monde - 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté - malgré un taux de croissance économique important (4% contre 1,2 en France par exemple).
Chronologie des événements
25 septembre 2025 : le mouvement contre les coupures d’eau et d’électricité rassemble des milliers de personnes malgré l’interdiction de manifester. Les liaisons aériennes sont suspendues.
26 septembre 2025 : Le président Andry Rajoelina limoge son ministre de l’Énergie
29 septembre 2025 : Le président annonce la dissolution du gouvernement du Premier ministre Christian Ntsay
Début octobre 2025: La Gen Z renouvelle ses appels à manifester malgré la répression violente envers les manifestants et les journalistes.
3 octobre 2025 : Dans un discours Facebook en direct, le président Andry Rajoelina a affirmé que « des pays ou des agences » seraient responsables d'une cyberattaque destinée à manipuler massivement les jeunes Malgaches pour provoquer le chaos et organiser un coup d'État.
4 octobre 2025 : Pour la première fois,une marche de soutien au pouvoir est organisée, qui ne parvient pas à mobiliser les foules
6 octobre 2025: Le président Andry Rajoelina nomme le général militaire Ruphin Zafisambo comme nouveau Premier ministre
11 octobre 2025: Les manifestant·es, escorté·es les militaires du Corps d'Armée des Personnels et des Services Administratifs et Techniques (CAPSAT) prennent la place du 13 mai.
12 octobre 2025 : La police nationale et la Gendarmerie se rangent du côté des manifestant·es. Le Capsat refuse de suivre les ordres du gouvernement. Le président Andry Rajoelina est exfiltré de la Grande Île - notamment par un avion militaire français - vers Dubaï, après, selon lui, avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Le chef du Sénat est démis de ses fonctions et le candidat de CAPSAT à la tête des forces armées est accepté par les autorités civiles.
13 octobre 2025 : un décret de la Présidence permet une remise totale de peine pour 8 prisonniers dont un Franco-Malgache condamné pour tentative de coup d’Etat ainsi que le directeur de publication de la Gazette de la Grande Île.
14 octobre 2025 : Le président dissout l’Assemblée nationale, qui était en train d’entamer une procédure de destitution à son encontre. Cette dernière est toutefois validée par la Haute Cour Constitutionnelle et les militaires du CAPSAT annoncent prendre le pouvoir pour deux ans.
Sources : Midi Madagasikara, RFI, France24, UNFPA, Courrier International, Banque Mondiale, TV5 Monde, LeMonde.
À lire
Entre la France et Madagascar, le business des « séjours de rupture » pour enfants placés
Trois associations accueillant depuis des années des jeunes de l’aide sociale à l’enfance notamment sur l’île de l'océan indien sont visées par une plainte de l’association Anticor. Leurs gérants sont accusés de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics, mais ils démentent toute irrégularité.
Une enquête de Louise Audibert pour Médiapart.
Pour la joie, Une ode à la résistance poétique et politique, Les liens qui libèrent
Dans un monde où les récits apocalyptiques saturent notre imaginaire, Pour la joie se présente comme un acte de résistance poétique et politique. En réunissant des artistes, écrivaines, universitaires et chanteuses, ce livre collectif a pour ambition de redonner toute sa place à la joie comme moteur de lutte et d’émancipation.
Face à la montée des fascismes et à l’essoufflement de la gauche, cette anthologie propose de dépasser les récits de colère et d’ouvrir un nouvel espace : celui des lendemains désirables. De la fête comme geste politique aux imaginaires artistiques réenchantés, ces textes explorent comment les créations collectives, les récits sensibles et les voix multiples peuvent porter un projet de société féministe, écologiste et antiraciste.
À travers une mosaïque de formes — fictions, poèmes, essais, témoignages —, Pour la joie est un manifeste pour réenchanter les luttes, cultiver l’espoir et construire ensemble un futur où la joie est un droit, une force, une stratégie pour toustes.
Rim Battal, Douce Dibondo, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Nadia Yala Kisukidi, Mélissa Laveaux, Fania Noël, Laura Nsafou, Coline Pierré - coordonné par Kiyémis.
À faire
Rencontre littéraire
Rencontre avec Christelle Tissot autour de l’essai « Full Santé Mentale » aux éditions Vuibert le 21 octobre à partir de 19h à la librairie “Un livre, une tasse de thé”.
Parité et élections locales
En 2022, les femmes représentaient 41,5 % de l’ensemble des élu·es locaux·ales. Une progression lente mais continue, qui masque encore d’importants déséquilibres dès qu’on regarde dans le détail. Elles sont par exemple seulement 19,8 % à occuper la fonction de maire, un chiffre en hausse par rapport à 2014 (16,1 %), mais qui reste désespérément bas. Plus on monte dans la hiérarchie, plus la place des femmes se réduit : elles sont à peine 11,8 % à présider une intercommunalité, contre près de 88 % d’hommes à ces postes. On retrouve ce déséquilibre aussi dans la répartition des adjoint·es : elles représentent 33 % des premier·es adjoint·es, 42 % des deuxièmes, et 45 % des autres. Les chiffres le montrent bien : les femmes sont là, mais pas encore tout à fait là où se prennent les décisions les plus structurantes.
Dans les communes de 1 000 habitant·es ou plus, où la parité est imposée par la loi, la proportion de femmes conseillères municipales est de 49 %. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitant·es, non soumises à cette obligation, elle est de 38 %. Pour remédier à cela, il a été nécessaire de faire évoluer la loi, non sans difficulté comme vous pouvez l’imaginer. C’est grâce à un texte adopté en avril 2025 (oui, ce n’est pas une faute de frappe) que la parité s’appliquera aussi dans les communes de moins de 1000 habitant·es pour les prochaines élections municipales de 2026. Côté LR et RN, certains parlementaires ont mis en avant leur “crainte” de voir leurs partis rencontrer des difficultés à constituer des listes faute de pouvoir trouver des candidates… Lorsque les femmes ne sont pas “compétentes” pour occuper des fonctions politiques, argument préféré des sexistes - pardon je voulais dire opposants à la parité -, elles tout simplement “pas là”. Intéressant comme argument, notamment lorsque l’on sait que les femmes représentent 51,6 % de la population en France.
Et des femmes, il en faut, surtout des féministes pour porter des mesures ambitieuses afin, entre autres, de lutter contre les violences sexuelles et sexistes en milieu rural. Une urgence quand l’on sait que 47% des féminicides sont commis dans des zones rurales. Alors n’en déplaise aux fâchés et fâcheux : oui, il faut renforcer la parité.
Il est assez évident que tout ne sera pas réglé, même avec une nouvelle loi sur la parité. Il y aura certes plus de femmes, mais elles continueront : à être victimes de sexisme dans les instances politiques, à occuper des postes “moins importants”, à s’occuper des délégations considérées comme “féminines” (petite enfance, éducation, etc.), à se faire harceler, etc. Loin de moi l’idée de vous décourager, il en faut des femmes - surtout des féministes - en politique au niveau local, mais il est important aussi de dépeindre la réalité d’une fonction qui peut s’avérer difficile et violente, surtout pour les femmes. En effet, les femmes élues souffrent davantage d’épuisement que les hommes élus comme le relève l’étude de l’observatoire Amarok sur le burn out des maires.
Mais s’il y a bien une chose que ces femmes élues locales incarnent, c’est une autre manière de faire de la politique. Une politique de proximité, plus concrète, souvent plus à l’écoute, et pourtant encore trop peu valorisée. Elles s’imposent dans des espaces qui, malgré la loi, malgré les chiffres en hausse, restent traversés par les mêmes réflexes de domination.