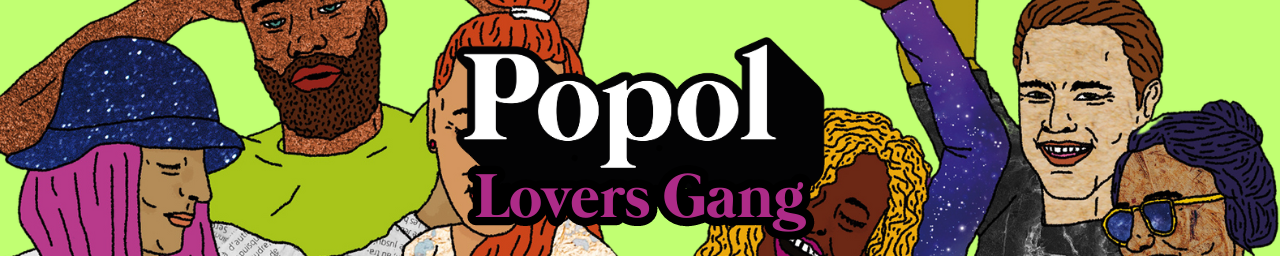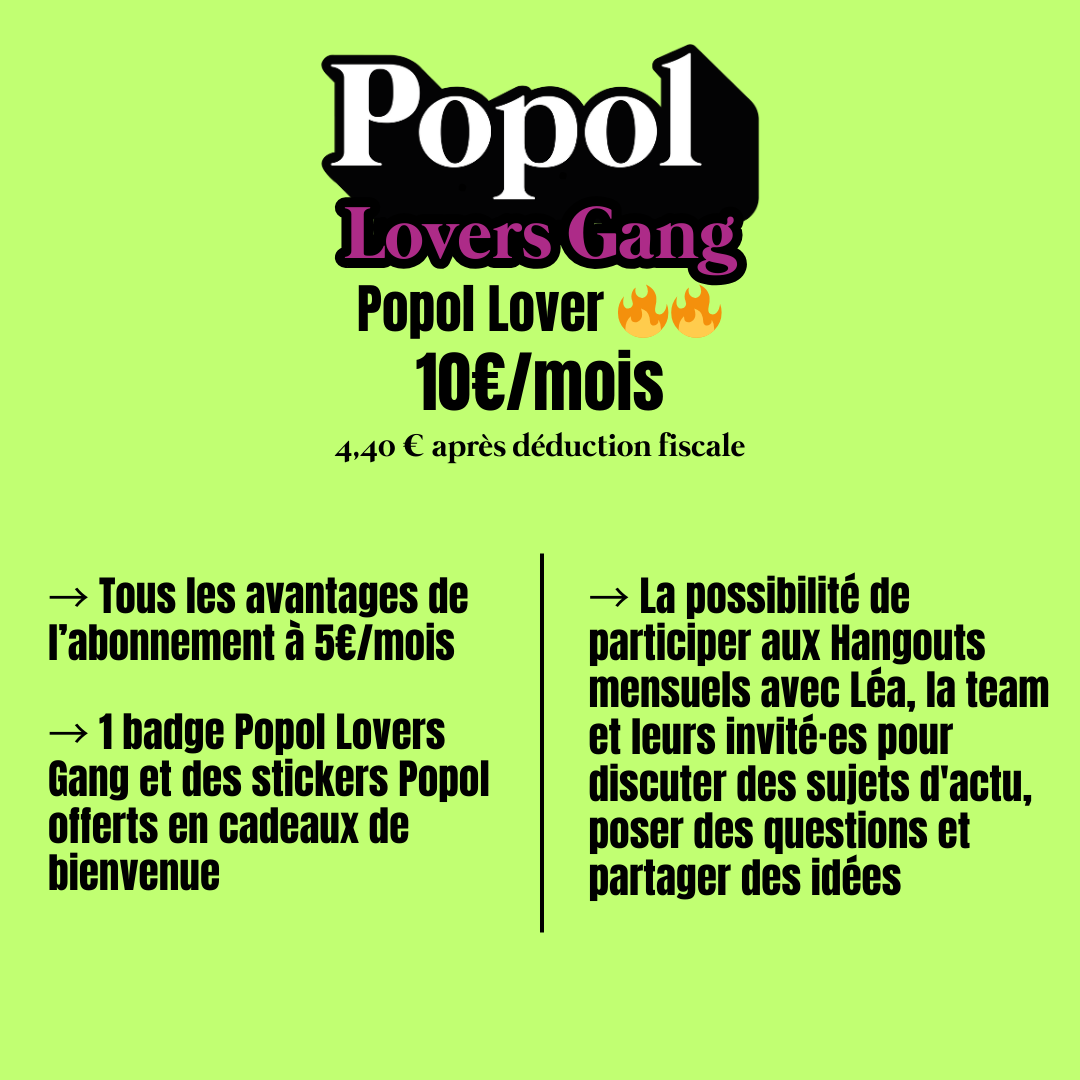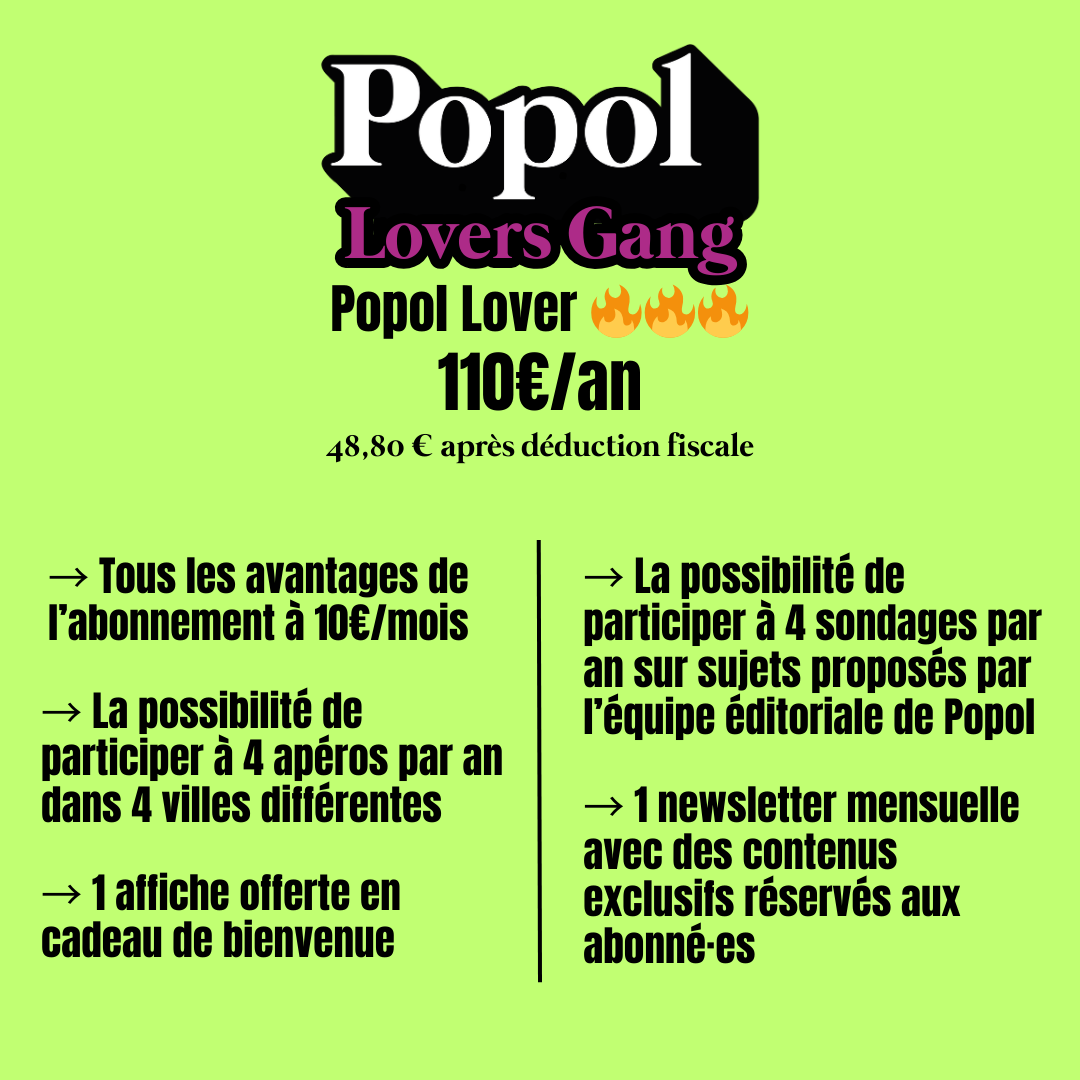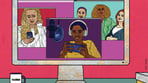Popol Post
Who cares?


Le Caring State, avenir de nos démocraties ?
Pour celles et ceux qui suivent mes travaux depuis un certain temps, vous connaissez déjà mon appétence pour les récits alternatifs et vous avez peut-être lu “Au revoir Simone !”. Aussi, vous ne serez pas surpris·es de me voir à nouveau disserter sur l’importance de déconstruire notre rapport au pouvoir afin d’imaginer une autre façon de faire société. Et lorsque j’ai effectué les recherches pour la rédaction de cet essai-fiction, je suis tombée sur le Care Manifesto. Un ouvrage collectif où les autrices et auteurs explorent, entre autres, le concept de “Caring State”.
Le Caring State y est décrit comme “Un État du care n’est pas un État vertical, hiérarchique, disciplinaire ou coercitif, mais facilite plutôt ce que Davina Cooper appelle “la tendance créative, horizontale et écologique du présent et du futur”. Un État du care œuvre nécessairement dans le sens de la justice sociale plutôt que de la justice pénale, tire les leçons du féminisme abolitionniste pour construire des communautés solidaires plutôt que des systèmes d’incarcération privatisés. Il encourage également de manière imaginative les “usages et espaces communs” en fournissant des institutions et des ressources ouvertes qui peuvent être supervisées par les citoyens à travers des processus démocratiques participatifs, tels que les assemblées de citoyens. En bref, l’État du care garantit les ressources nécessaires à la promiscuité des soins tout en permettant aux communautés de s’épanouir.” (The Care Collective, Care Manifesto: The Politics of Interdependence, Verso Books, 2020, p. 50).
C’est tentant, n’est-ce pas ?
Un État du care, et pourquoi ne pas y croire ? Pourquoi ne pas s’autoriser à rêver d’une autre forme d’organisation politique où le pouvoir ne serait plus synonyme de domination et où les institutions seraient au service du bien-être collectif ?
Car rêver d’un Caring State ce n’est pas seulement rêver d’une version améliorée de l’État providence. C’est une critique radicale, et profondément féministe, du modèle politique dominant, qui valorise la performance, la verticalité, la rationalité froide et les logiques de profit.
C’est prendre au sérieux ce que les féministes disent depuis longtemps : la vie ne tient pas debout sans soin. Sans soin apporté aux enfants, aux malades, aux personnes âgées, à celles et ceux qui n’entrent pas dans les cases de la productivité normative. Sans soin porté aux liens, à la démocratie, au vivant.
Le Care Manifesto nous le rappelle : nous vivons dans un monde structuré par l’interdépendance, et non pas par l’individualisme et l’isolement. Nous avons besoin des un·es et des autres pour vivre c’est un fait biologique, social et politique. Pourtant, notre organisation collective continue de déléguer le soin à la sphère privée, aux femmes, aux plus précaires, aux personnes racisé·es. Ce n’est pas un oubli : c’est une violence systémique.
Penser un Caring State, c’est politiser le care d’un point de vue collectif. C’est affirmer que le soin est une responsabilité que nous partageons tout·es pour tout·es. Ce n’est pas une charge individuelle visant qui vise à promouvoir le développement personnel. C’est proposer que l’État investisse massivement dans ce qui permet à une société de tenir : crèches, hôpitaux, services publics de proximité, accompagnement à la parentalité, prise en charge du grand âge, protection de l’environnement, etc.
C’est aussi sortir du piège du care sacrificiel. Le féminisme du care ne dit pas que les femmes doivent s’occuper de tout le monde, il dit que la société toute entière doit se réorganiser pour partager, reconnaître et valoriser ces tâches de reproduction. Il appelle à sortir de l’essentialisation et des stéréotypes genrés pour construire une politique de la sollicitude, de l’attention et de la coopération.
Dans un monde où les crises se multiplient et où nos conquis démocratiques et sociaux sont menacés en permanence, rêver d’un Caring State est une utopie nécessaire. C’est un projet exigeant, révolutionnaire et ancré dans la réalité des luttes féministes.
Et si ce modèle suscite encore des ricanements dans les sphères de pouvoir, c’est peut-être justement parce qu’il bouscule l’ordre établi : celui qui fait de la domination un mode de gouvernance, et de l’indifférence un principe politique.
Alors oui, rêvons. Mais organisons-nous aussi pour faire advenir un État du soin, un État féministe, un État du vivant !
Les femmes sociales
En première ligne des ravages de l’association délétère du capitalisme et du patriarcat, elles savaient que la question n’était pas seulement « d’aider les gens » mais aussi d’interroger les causes de la misère et l’efficacité des réponses que la société y apporte…
Alors que nous faisions des recherches sur la question du soin et du care, prêtes à écrire un article bien senti sur le dévouement des femmes, nous sommes tombées sur un article de la sociologue Yvonne Knibielher, récemment disparue et à laquelle nous en profitons pour rendre hommage, intitulé « vocation sans voile : les métiers sociaux. ». Dans cet essai passionnant, elle revient sur l’histoire du travail social et plus particulièrement le rôle des femmes célibataires dans l’action sociale en France. Il nous a semblé important de revenir sur cette histoire, d’enraciner cette question hautement contemporaine dans une histoire, d’éclairer encore un peu plus sa dimension hautement politique.
La naissance du travail social en tant que tel est liée à l’émergence de la société industrielle, au XIXème siècle, et à son corollaire, l’urbanisation. A mesure que les villes et les usines se développent, la seule charité chrétienne ne suffit plus à faire face à ce que les hommes politiques de l’époque appellent la « question sociale ». Les familles s’entassent dans des logements insalubres, dans des villes et des faubourgs qui n’y sont pas du tout préparés. Les maladies et les caractères hautement insurrectionnels d’une telle promiscuité, dans d’aussi mauvaises conditions, inquiètent les patrons. Alors même qu’elles étaient exclues de la vie politique et de l’espace publique, ce sont les femmes qui, les premières, vont faire lien entre les différentes classes sociales. Déjà, avant l’ère industrielle, les « visites aux pauvres » leur étaient essentiellement dévolues et c’est ce qui donnera d’ailleurs cette impression tenace que les fameux métiers sociaux, que l’on appelle aussi les métiers du care ne sont qu’une professionnalisation d’un rôle traditionnellement dévolu aux femmes et aux mères et qui revient à s’occuper des autres, nourrir, dorloter, accompagner, soigner. C’est en partie vrai.
Lorsqu’il est devenu évident que le bénévolat ne suffisait plus à endiguer les effets de l’industrialisation massive, ce sont donc les femmes qui ont intégré le travail social. Et les femmes seules en particulier. Pour les filles de la bourgeoisie, c’était une manière de sortir de leur condition, un « tremplin et un atout » pour reprendre les termes d’Yvonne Knibielher, un moyen, en se colletant aux problèmes socio-économiques, de prendre part à la vie publique et politique. Pour les « vieilles filles », c’était l’occasion de voir son existence valorisée. Contrairement aux religieuses, le renoncement au mariage pour se consacrer à leur tâche n’est pas un acte d’humilité et de soumission au Seigneur, mais bien un acte d’émancipation. Il ne s’agit pas seulement de faire la charité au plus pauvre comme les quatre filles du Docteur March mais bien de s’investir dans la société et de faire reculer les écarts de pauvreté.
Dans la revue La femme contemporaine fondée en 1896 par la féministe Marie Maugeret on peut lire le passage suivant : « (…) La femme qui a déjà donné son nom au XIXeme siècle, c’est la femme sociale, celle qui a franchi le seuil de la maison pour se rendre compte de ce qui se passait au dehors, celle qui s’est penchée sur des souffrances dont les plaintes jusqu’alors n’étaient point parvenues jusqu’à elles. C’est la femme qui a planté dans le sol tourmenté d’une fin de siècle à peine convalescent du cataclysme de 1789, la forêt touffue des œuvres nouvelles de forme et de nom, adaptées à des besoins nouveaux aussi de forme et de nom et, à bien prendre, toujours les mêmes. »
Yvonne Knibielher identifie trois générations de « femme sociale ». Avant la Première guerre mondiale, ce sont « les pionnières », souvent des femmes issues de la grande-bourgeoisie qu’absolument rien n’oblige à travailler et encore moins à renoncer à la vie de famille mais qui voient dans le travail social la possibilité de servir un autre idéal que celui de la maternité et de la vie domestique : le rapprochement entre les classes sociales. Elles sont souvent dotées d’un esprit d’entreprenariat que ne renierait pas nos start-upeurs actuels. Mathilde Girault, Appoline de Gourlet, Mademoiselle de Joannis ont fondé des œuvres et des écoles sociales gérées d’une main de maître. Même chose pour Léonie Chaptal, dont le frère est vicaire de paroisse, et qui a fondé deux dispensaires er des œuvres d’assistance maternelle et infantile. Si ça se trouve cette abnégation au service d’autrui n’était qu’un alibi pour laisser libre cours à leur sens des affaires et à leur combattivité, mais il n’empêche : elles ont fait tout ça.
La génération suivante se professionnalise dans les années 20. Après le drame de la Première Guerre mondiale, les femmes de la bourgeoisie ne sont plus aussi riches et leur engagement, autant que l’ampleur de leur tâche, nécessitent une vraie rémunération. D’après Yvonne Knibiehler, l’engagement est souvent le prolongement du scoutisme où les jeunes filles entraient pour quitter la famille et appartenir ainsi à un groupe qui ne serait pas celui du foyer. Les jeunes filles y apprennent, non pas seulement à tenir une maison, mais le service aux autres, la confiance en soi, la capacité à s’organiser.
Quelles que soient leur motivation, ce sont les femmes seules qui, les premières ont navigué hors de leurs milieux sociaux et les railleries sur les vieilles filles et les dames patronnesses paraissent d’autant plus injustes quand on comprend la réalité à laquelle elles étaient confrontées. On vante l’héroïsme des écrivains-voyageurs et des explorateurs. Mais peut-on imaginer à quoi ces femmes, certes souvent issues de classes bourgeoises et aisées, ont été confrontées. La souffrance des corps, la violence du travail, la maladie, le désespoir. Le rappel de l’importance du travail des femmes et notamment des travailleuses du « care » n’est pas seulement une vieille rengaine gauchiste, ni un romantisme surplombant, c’est le rappel nécessaire de la place qu’occupe les femmes dans notre vie économique.
On peut continuer à refuser de le voir, la réalité n’en demeure pas moins. Ces femmes ne sont pas des oubliées de l’histoire. Leur travail a été chroniqué, étudié, documenté, certaines même comme Céline Lhotte ont pris la plume pour raconter son expérience dans les taudis de la banlieue du Havre en 1928. Céline Lhotte écrira plus de 35 livres, dont des romans. Ses écrits que l’on peut qualifier de « populistes » sont aussi teintés de sa foi religieuse, mais elle a beaucoup œuvré pour que le travail des assistantes sociales et des infirmières médicales soient connus et reconnus et surtout pour faire état de ce dont elles étaient témoins. Missionnées, ces femmes n’étaient pas toujours dupes du rôle qu’on leur faisait jouer et elles avaient parfaitement conscience que le sens du sacrifice de ne suffirait pas. Qu’il n’était pas question de leur douceur, de leur aptitude innée à prendre soin mais bien de savoir dans quelle société nous aurions envie de vivre. En première ligne des ravages de l’association délétère du capitalisme et du patriarcat, elles savaient que la question n’était pas seulement « d’aider les gens » mais aussi d’interroger les causes de la misère et l’efficacité des réponses que la société y apporte.
Infanticides environnementaux
Chez les enfants, les conséquences de la pollution atmosphérique sont l’augmentation des naissances prématurées, de l’asthme ou encore, de façon importante, celle des bronchiolites ou cancer du poumon.
En 2023, l’Union Européenne s’est prononcée pour l’interdiction des polluants dits “éternels”. Ceux-ci correspondent à des composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés appelés PFAS et considérés comme “les poisons du siècle”. On retrouve ces molécules dans les objets du quotidien (poêles en Teflon, papier cuisson, emballages alimentaires, textiles, cosmétiques…) et dans les applications industrielles (mousse anti-incendie, peintures, pesticides, …). Les PFAS peuvent entraîner des problèmes de santé tels que des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité, des problèmes de fertilité et des cancers. Ces “polluants éternels” ont contaminé tous les milieux (eau, air, sol) et l’ensemble de la chaîne alimentaire. Les chiffres font peur : l’ensemble de la population européenne est contaminé par les PFAS dont les enfants, dès leur naissance ; il n’existe pas de système métabolique qui ne soit pas affecté par ces polluants. Malheureusement, les PFAS ne sont pas les seuls à mettre les enfants en danger ; le spectre des pollutions environnementales entraînant des maladies graves est très étendu.
Une idée préconçue voudrait que ce soit les enfants vivant dans les grandes villes les plus exposés aux risques de pollution. L’exemple le plus courant est celui de l’air extérieur. En effet, en France, il y a environ 48 000 décès liés à la pollution de l’air, soit la troisième cause de mortalité après l’alcool et le tabac. Chez les enfants, les conséquences de la pollution atmosphérique sont l’augmentation des naissances prématurées, de l’asthme ou encore, de façon importante, celle des bronchiolites ou cancer du poumon. Une étude récente de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en santé publique et sociale) démontre que les enfants les plus défavorisés sont plus touchés parce qu'ils vivent plus souvent au sein des aires d'attraction économiques des villes (et donc des industries ou usines) et dans les communes les plus polluées.
Une pollution de l’air qui touche tous les enfants sans distinction géographique est celle de l’air intérieur, il peut être jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur. Les sources de pollution dans les logements sont nombreuses : tabagisme, moisissures, matériaux de construction, meubles, acariens, produits d’entretien, peintures... De par leur petite taille, les enfants sont plus près du sol, là où s’accumulent les polluants. Leur rythme de respiration est 2 fois plus soutenu que celui des adultes et ils respirent une plus grande quantité d’air relativement à leur taille. Cette pollution entraîne des problèmes respiratoires : respiration sifflante, rhinites, asthme, irritation de la gorge, congestion nasale, toux sèche mais aussi de l’eczéma, dermatite, conjonctivite, irritation de la peau et des yeux. La pollution de l’air intérieur impacte également les performances scolaires car elle réduit les capacités de concentration et de mémorisation. La performance cognitive réduite, les difficultés à dormir s’accumulent, le cerveau est mal oxygéné ; les enfants sont plus fatigués et peuvent même souffrir de maux de tête. Mais là encore, il ne faut pas penser que cela se passe principalement dans le foyer, en dehors du logement familial, c’est l’école qui présente le plus gros risque d’exposition à la pollution de l’air intérieur : les enfants passent plus de 40% de leur temps en classe. Les chiffres sont effarants : 3 écoles sur 4 ne sont pas équipées de ventilation mécanique, environ 10 % des écoles présentent au moins un élément dégradé avec une concentration de plomb supérieure à 1 mg/cm² qui dépasse le seuil réglementaire, les écoles les plus anciennes dépassent le seuil d’insalubrité ou les cours goudronnées qui augmentent les îlots de chaleurs et donc les inhalations goudronnées. Là encore, les enfants vivant dans des familles précaires sont plus exposés à cette pollution à cause d’habiter dans des logements plus prompts à une mauvaise aération et isolation et donc à la moisissure ou aux produits toxiques. Ils fréquentent aussi des écoles plus dégradées. Alors, en plus du risque sanitaire, la pollution de l’air devient un facteur de réussite scolaire.
Cependant, on ne peut pas penser que la santé des enfants des milieux plus ruraux est plus protégée. Du fait de vivre à proximité de champs d’agriculture conventionnelle, l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) pointe l’augmentation du risque de leucémies, de cancers et de troubles neurologiques lors de l’exposition directe aux pesticides pendant la grossesse ou la petite enfance. Les pesticides, qu’ils soient professionnels par les épandages, ou domestiques par exemple pour le traitement des plantes au sein des jardins, polluent l’air, s’infiltrent dans les sols et polluent les cours d’eau, pour se retrouver dans le quotidien des familles. Une récente étude, encore de l’Inserm, a identifié que les enfants vivant près d’exploitations vinicoles ont un risque de leucémie lymphoblastique 10% supérieur à la moyenne. En effet, les vignes sont parfois traitées aux pesticides jusqu’à 19 fois par an. En Guadeloupe et Martinique, il a été démontré que l’exposition prénatale et postnatale au chlordécone, pesticide dangereux utilisé pour la culture bananière, est associée à une diminution des capacités intellectuelles et à une augmentation des difficultés comportementales chez les plus jeunes.
Malheureusement, la liste des facteurs environnementaux entraînant des maladies pédiatriques graves ne s’arrête pas aux pollutions de l’air et aux pesticides. L’industrie est une autre grande coupable. Début 2000, l’histoire des enfants vivants à proximité de l’usine Kodak de Vincennes avait secoué bon nombre de parents. Cinq enfants vivant à proximité de l’usine ont développé des cancers. C’est le tournant de ce qu’il s’appelle aujourd’hui les clusters de cancers pédiatriques. L’activité de certaines industries rejettent dans l’air et dans l’eau des métaux lourds et terres rares dont les concentrations sont souvent supérieures à la réglementation. Même si les mesures ont été durcies, les infractions restent courantes. Le taux de cancers pédiatriques augmente alors fortement, les maladies rares du sang et les leucémies étant prédominantes. Actuellement, il existe 4 clusters de cancer pédiatriques connus. À Igoville dans l’Eure, c’est une usine de fabrication de vannes et de tubes spéciaux pour les secteurs de la défense, du nucléaire et de la pétrochimie qui est suspectée. À Pont-de-l’Arche en Loire Atlantique, 25 enfants ont déclaré un cancer entre mai 2015 et mai 2021. À Saint-Rogatien en Poitou-Charentes ou encore autour de Rousses dans le Haut Jura, les cancers pédiatriques explosent avec suspicions d’industries coupables. Plus récemment, c’est l’usine Sanofi de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) qui est dans le viseur des familles. Celle-ci produit la Dépakine depuis 1967, médicament prouvé responsable de malformations et de troubles neurodéveloppementaux chez des milliers d’enfants de mères traitées pendant leur grossesse. Malgré son interdiction chez les femmes enceintes, des pathologies similaires sont présentes chez des enfants de riverains de l’usine et de travailleuses fréquentant la zone industrielle. Aucune mère n’a pris le médicament, toutes s’interrogent sur le lien avec les rejets dans l’air de valproate de sodium, son principe actif, autour du site.
Aujourd’hui, seulement une infime partie de l’impact sanitaire des polluants et facteurs environnementaux sur les enfants est connue. Devant le manque de moyens ou d’écoute des organismes de santé publique, de nombreux parents s’organisent pour faire leurs propres recherches et montent des collectifs de vigilance citoyenne. Il existe une réelle inaction politique sur la recherche des clusters de cancers pédiatriques et dans la protection des enfants contre la pollution plus généralement. Il ne faut pas avoir peur de dire que le bilan de l’État est accablant. Depuis 2008, les directives européennes sur la qualité de l'air ambiant obligent les États membres de l'Union européenne à prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites et cibles dans un délai spécifié. Cependant, rien ou presque, n’est fait pour améliorer la pollution de l’air en France, et ce malgré une première condamnation en 2017 par le Conseil d’État. Celle-ci sera suivie d’autres en 2021, 2022 et 2023 obligeant la France a payé 30 Millions d’amendes face à la persistance de ces dépassements, alors que le danger de la pollution de l'air n’est plus à prouver.
Enfin, concernant les pesticides, les reculs s’accumulent. Dès 2007, le Grenelle sur l’environnement avait pris un engagement de réduction de l’usage des produits phytosanitaires jusqu’à son interdiction. Dix en plus tard, Macron 2017 promet que le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans trois ans. Non seulement la promesse n’a pas été tenue mais le gouvernement a même fait un revirement. Il a autorisé la réintroduction des néonicotinoïdes dans les cultures et la France s'abstiendra lors du vote de la proposition de la Commission européenne sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour dix ans dans l'UE.
Jean-Paul Jaud sortait en 2008 l’indispensable documentaire “Nos enfants nous accuseront”. Non seulement c’est toujours d’actualité, mais ils auront bien raison.
Et si le journalisme était un métier du soin ?
Aujourd’hui je vous fais part de réflexions plus personnelles sur ce métier. Dans ce numéro sur le thème du soin, il me paraissait indispensable d’y inclure le métier de journaliste. Il est vrai qu’il n’est pas naturel de faire ce lien entre information et soin, ou encore entre médias et soin. Avec 90% des cartes de presse situées à Paris et des sièges de médias nationaux qui ont du mal à quitter la capitale malgré toutes les possibilités technologiques à disposition, les rédactions nationales semblent souvent déconnectées des réalités du quotidien. Les « marronniers » tels que l’approche de l’été, les premiers flocons de neige, les galettes des rois et autres poncifs donnent plus de condescendance de d’information, et au mieux une certaine vision du divertissement.
Et si le journalisme était pourtant un métier du soin ? C’est une des questions que pose Nina Fasciaux dans son livre Mal Entendus (Payot, 2024), qui permet notamment de remettre le journalisme à sa place originelle - la médiation. Elle écrit « la part de responsabilité que le journalisme tient dans l’exacerbation du débat public pourrait tout à fait être renversée: le journalisme constitue en effet un formidable vecteur pour faciliter le dialogue et créer du lien, encourager la pensée critique ». On entend souvent dire que « la société est polarisée », « de plus en plus radicale » (n’est-ce pas les féministes?), et pourtant, quand on analyse les choses, la majorité silencieuse est encore là et représente un véritable poids dans la société.
L’ObSoCo qui a étudié les phénomènes d’exodes et fatigue informationnel·les, a en effet observé que dans les études qu’il publie, il y a bien 20% des Français·es très opposé·es ou très favorables, ce qui signifie bien que 60% des Français·es ne sont ni radicalement opposé·es ni radicalement favorable. Et l’enjeu journalistique est bien d’en rendre compte, de créer du lien et d’en prendre soin. On sait l’enjeu démocratique des élections où il reste tant de voix à convaincre. Entendons-nous, il ne s’agit pas ici de juger ce qui est fait, mais de porter une attention particulière à l’écoute. Si dans l’apprentissage du métier on comprend comment poser des questions et mener des entretiens, on accorde encore trop peu d’importance aux techniques qui permettent de recevoir les réponses. Car oui, cela s’apprend.
C’est une des raisons qui m’amène aujourd’hui à considérer qu’il y a presque autant de journalismes que de journalistes dont la seule ligne rouge serait réellement la déontologie et les atteintes à leurs libertés fondamentales dans leur rôle d’information. Ce texte est un édito ; je me réserve donc le droit de changer d’avis à ce sujet.
Voir le journalisme comme un métier du soin, c’est penser que l’écoute est primordiale et qu’en plus de savoir poser des questions, il est temps d’apprendre à recevoir les réponses. C’est là aussi comme cela que l’on peut aider à renouer la confiance et prouver notre utilité.
Voir le journalisme comme un métier du soin, c’est considérer une interview comme l’apprentissage d’une langue étrangère. La personne que nous avons en face de nous est une personne que l’on ne connaît pas et l’emploi de nos mots n’aura pas la même charge significative pour elle.
Voir le journalisme comme un métier du soin, c’est considérer que le travail repose sur la coopération plutôt que l’information à tout prix (et souvent à toute vitesse). Et voir fleurir les collectifs de journalistes, c’est bien un indice.
Voir le journalisme comme un métier du soin, ce n’est pas « faire un moment » mais, plus humblement, prendre en compte celui qui est déjà là sans causer de disruption. Et c’est peut-être là que se dessine la crédibilité.
Voir le journalisme comme un métier du soin, c’est vouloir complexifier les récits pour répondre à la curiosité des citoyen·nes.
Voir le journalisme comme un métier du soin, c’est aussi prendre soin de ses sources, leurs récits et comprendre leurs blessures.