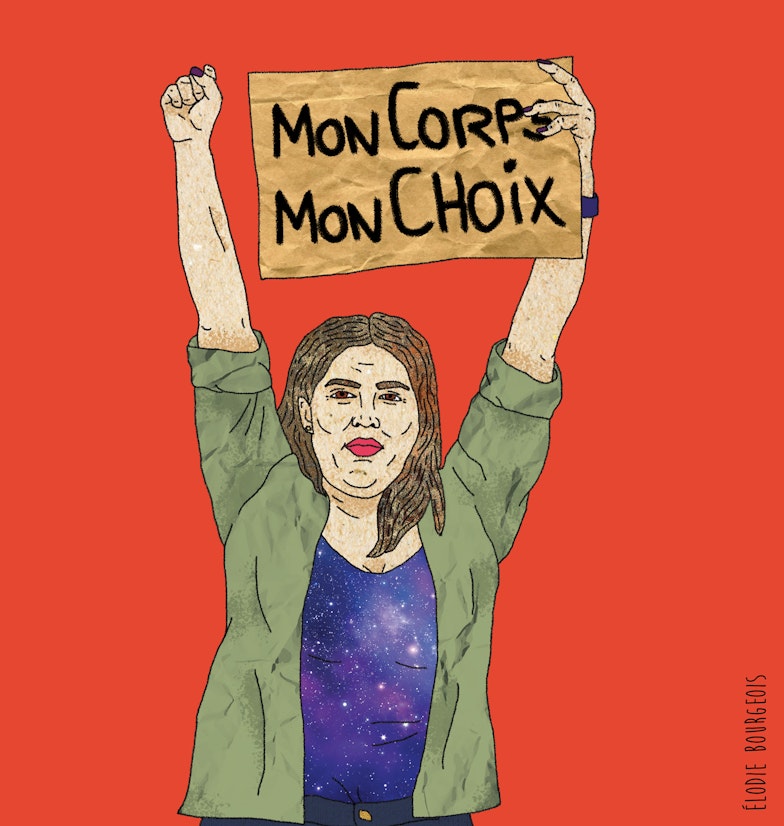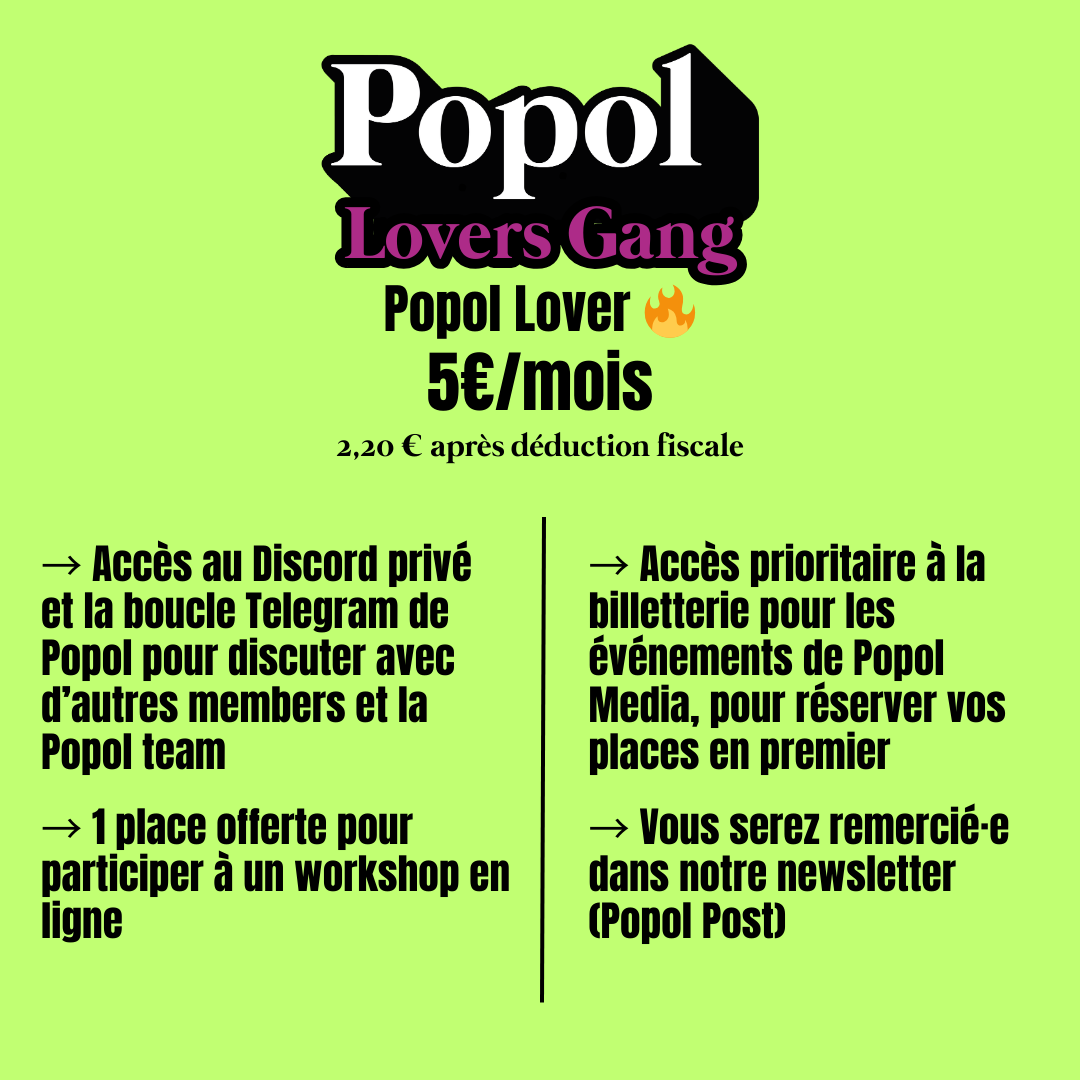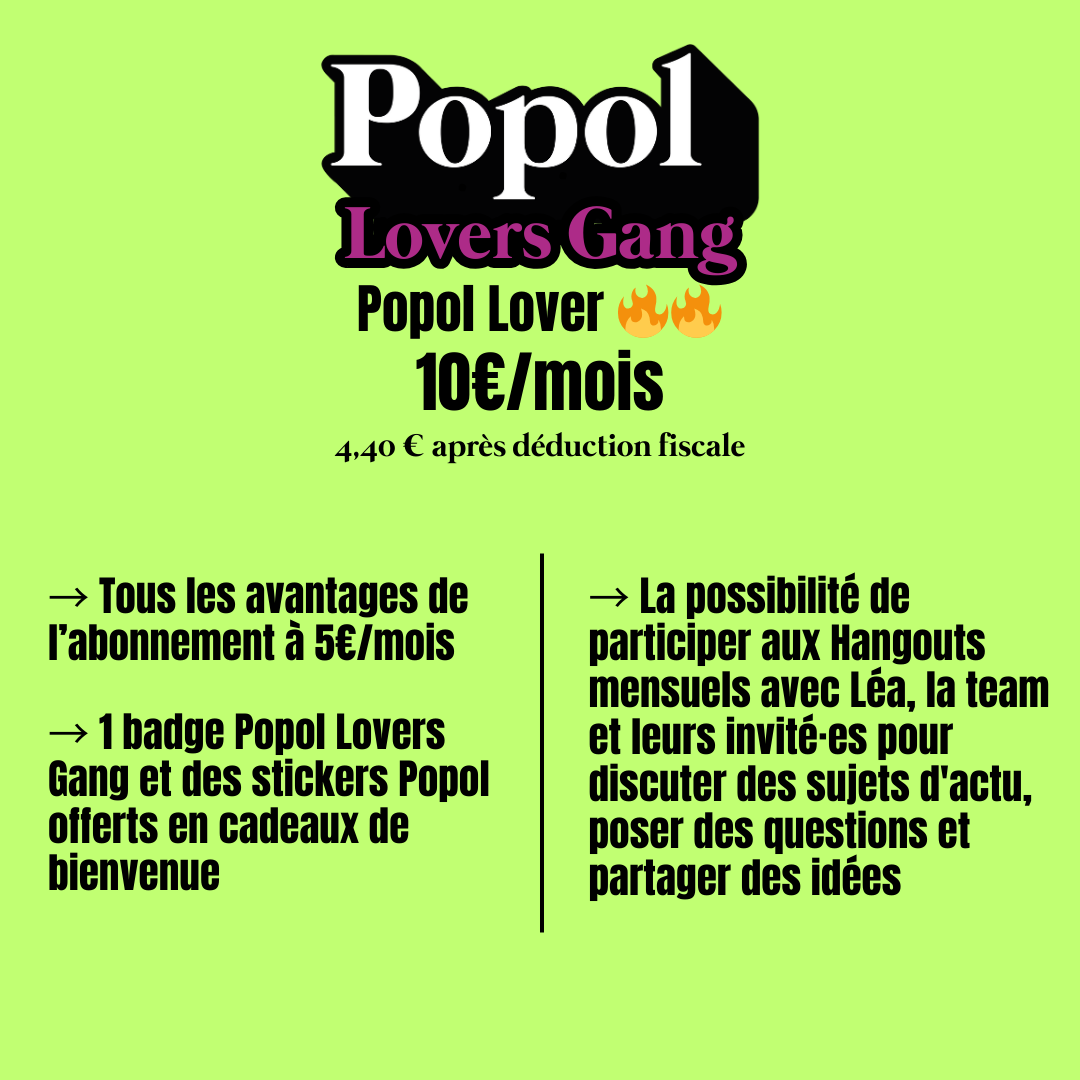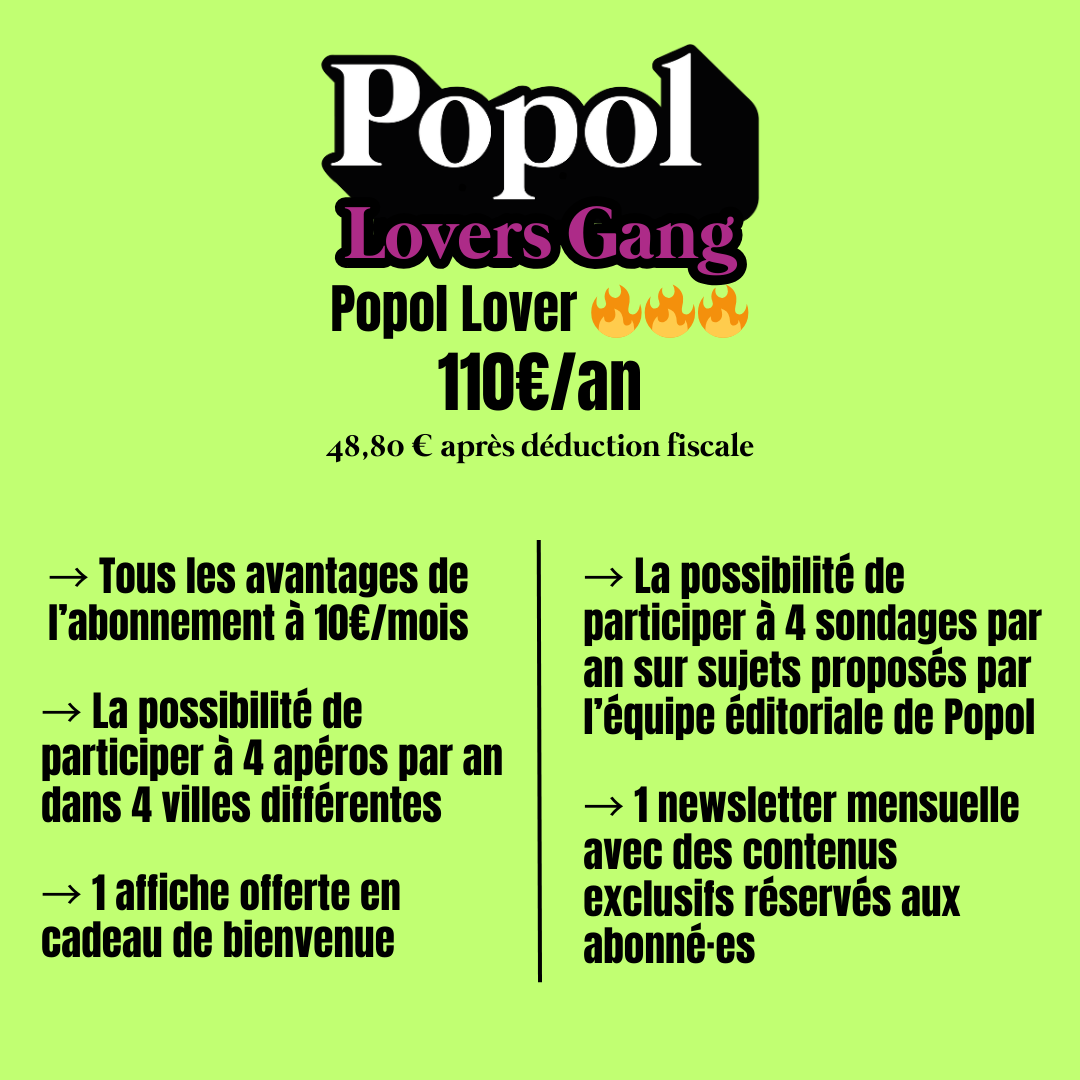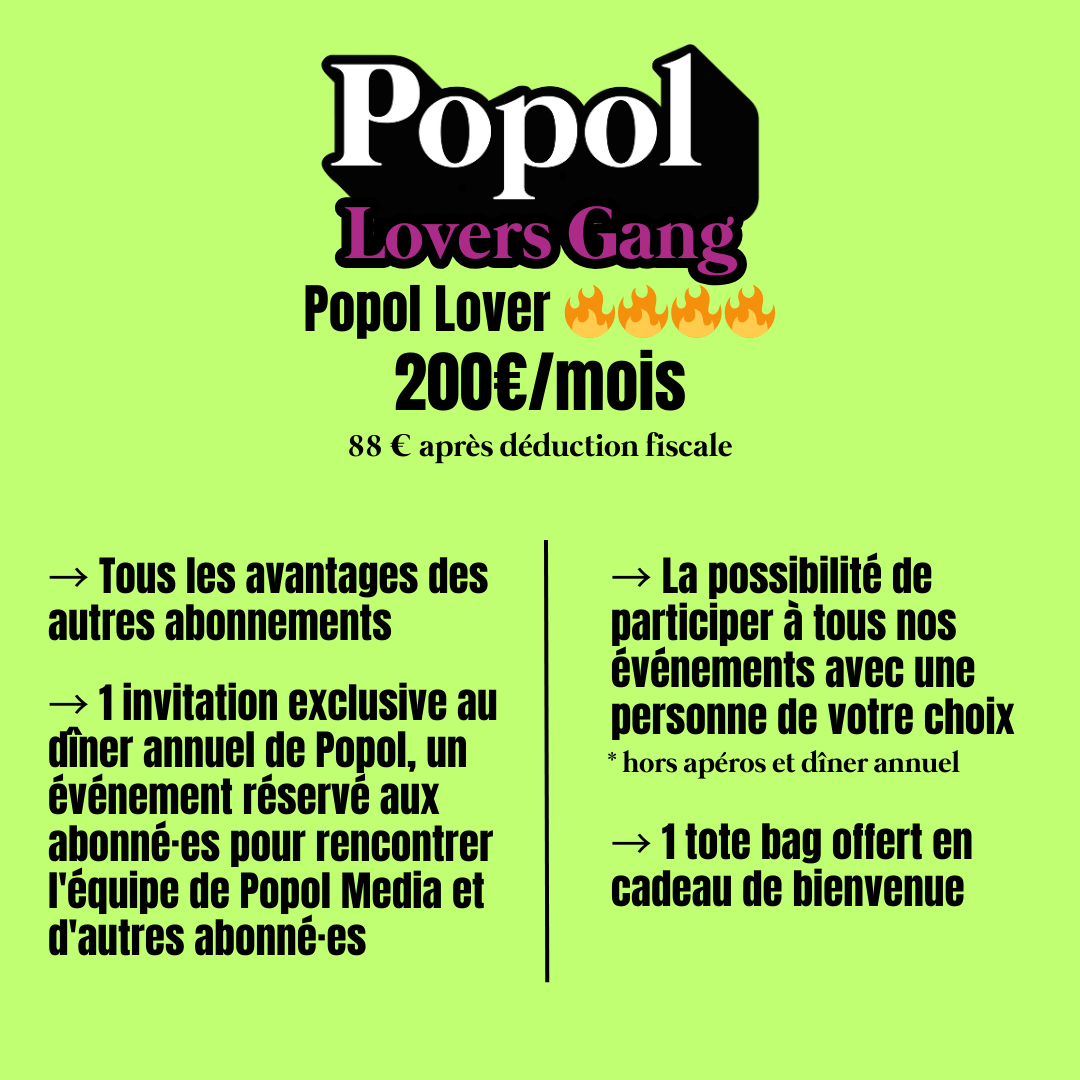Popol Post
50 ans de la "loi Veil", le mouvement 4B, interview exclusive de Lina Chawaf, Nature is Queer, etc.

Popol Post
10 min ⋅ 23/01/2025
50 ans après la loi Veil, le droit à l’IVG toujours menacé
Le 17 janvier 2025 marquait le 50ème anniversaire de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), dite “Loi Veil”. Cette loi, votée le 17 janvier 1975, prévoit alors une dépénalisation du recours à l’IVG encadrée par un certain nombre de conditions cumulatives parmi lesquelles : une situation de détresse, une grossesse inférieure ou égale à 10 semaines, une intervention réalisée par un médecin dans un établissement d'hospitalisation, etc. Il faudra ensuite attendre 1982 pour que l’IVG soit remboursée par la sécurité sociale et 2001 pour que le délai soit allongé à 12 semaines et que les mineures n’aient plus à obtenir une autorisation de leurs responsables légaux. En mars 2022 est votée la loi portée par Albane Gaillot prévoyant l'allongement du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Cette réforme a également permis de supprimer le délai de réflexion de deux jours, autrefois imposé afin de confirmer une demande d’avortement après un entretien psychosocial. Enfin, le 8 mars 2024, la liberté de recourir à l’IVT a été inscrite dans la Constitution de la République.
Nous célébrons donc en ce mois de janvier 2025 50 années d’avancées législatives et de luttes militantes et politiques qui ont été précédées par des événements forts, gravés dans notre mémoire collective comme le Manifeste des 343 en 1971 et le procès de Bobigny en 1972, suite auquel le ministre de la Justice de l’époque a donné consigne au Parquet de ne plus poursuivre les avortements. Et il est important de rappeler que, malgré l’incarnation qu’elle représente à cet égard et le rôle fondamental qu’elle a pu jouer pour inscrire ce droit dans la loi, la lutte pour la légalisation de l’IVG ne repose pas que sur Simone Veil mais bien sur des milliers de femmes - et d’hommes - qui ont oeuvré pour faire du recours à l’avortement un droit.
Et il est aussi important de souligner que ce droit a évolué au cours de cette moitié de siècle, malgré les attaques qui n’ont pas cessé depuis 1975. Attaques qui, comme le rappelait Simone Veil lors d’un entretien accordé au journal L’Humanité en 2005, revêtent un caractère particulièrement violent et virulent : “J’ai été très surprise de voir certains des parlementaires avec qui j'entretenais des relations amicales tomber dans le machisme et la virulence, surtout quand ils évoquaient les raisons religieuses et philosophiques de leur rejet de la légalisation de l'avortement. Je savais que je pouvais compter sur le soutien des socialistes et des communistes. Il n'est jamais très agréable, quand on est dans une majorité, de compter sur l'opposition pour faire passer son projet, et que certains dans votre camp vous injurient à outrance.” (Entretien de Simone Veil dans L’Humanité, republié dans leur hors-série consacré au droit à l’IVG).
Malheureusement, les diverses avancées législatives n’ont pas permis d’enterrer les menaces qui pèsent sur ce droit et le camp des anti-choix gagne de plus en plus de terrain à travers le monde, comme en témoigne la déconstitutionnalisation de l’accès à l’IVG aux Etats-Unis en 2022.
En outre, et alors que ce droit (requalifié pour l’occasion en liberté) a intégré la Constitution il y a un peu moins d’un an, une analyse de son accès sur l’ensemble du territoire s’impose. Ce travail d’analyse a été réalisé par des associations féministes à l’instar du Planning familial qui a commandé le tout premier baromètre relatif à l’accès à l’avortement réalisé en septembre dernier par l’IFOP. Dans ce baromètre, on apprend notamment que la population française est très attachée à ce droit (85 % des personnes sondées) mais qu’il y a toujours une appréhension à en parler librement (2 femmes sur 3 ayant recours à une IVG ont peur d’être jugées ou de subir des remarques de leur entourage).
Par ailleurs, la présidente du Haut Conseil pour l’égalité, Bérangère Couillard affirmait dans les pages du Hors-série de L’Humanité consacré à l’IVG qu’“Encore 17% de femmes avortent dans un territoire qui n’est pas le leur. Elles sont toujours entre 3 000 à 5000 à partir à l'étranger. Quatre femmes sur dix n'ont pas le choix de la technique d'avortement, avec 80 % d'IVG médicamenteuses.”
Mais alors, que faire pour améliorer cette situation ? La question de la suppression de la clause de conscience est une piste qui est souvent mise en avant par les associations et les professionnel·les. Néanmoins, il est apparu pendant l’examen de la proposition de loi de l’ancienne députée Albane Gaillot sur l’allongement du délai de recours à l’IVG, que l’exécutif - et plus particulièrement le président de la République n’y était pas favorable. Ainsi, il apparaît assez peu probable, compte tenu également de la situation politique actuelle, qu’une telle mesure soit adoptée à court terme. Pour pallier les difficultés d’accès, le Planning familial a récemment publié 10 recommandations ayant pour objectif : de mieux informer, de simplifier le parcours et de garantir une offre sur l’ensemble du territoire.
Les pistes existent pour garantir un accès effectif et égal sur l’ensemble du territoire, mais encore faut-il que la volonté politique suive… Et à cet égard, rien n’est trop sûr.
“Celles qui avaient renoncé aux hommes”
L’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis a vu le triomphe du capitalisme le plus fou, des pensées les plus réactionnaires et surtout elle marque le plus gigantesque backlash que le féminisme ait connu ces dernières années, avec l’essor d’un masculinisme complètement décomplexé. Nous avions déjà abordé dans Popol, lors des élections américaines de novembre 2024, le gender gap, cet écart de vote qui sépare les hommes et les femmes. Aux États-Unis, le gouffre n’a jamais été aussi béant, notamment lorsque l’on regarde le vote des femmes racisées. Et les étatsuniennes, premières victimes du trumpisme, s’organisent.
Dans un article du Monde daté du 2 décembre 2024, la journaliste Coline Clavaud-Mégevand revient sur le mouvement 4B et explique comment il gagne du terrain chez les femmes étatsuniennes au point de devenir un phénomène de société. Le 4B est apparu en Corée du Sud dans les années 2010 et vise à encourager les femmes à se libérer des normes et de la pesanteur des attentes patriarcales. Comme le nom l’indique le 4 B obéit à 4 règles : Bi Hon, ne pas se marier avec des hommes. Bi Yeonae, ne pas sortir avec des hommes. Bi Sex, ne pas avoir de relations sexuelles avec des hommes. Bi Chulsan, ne pas avoir d’enfants. Dans la société coréenne très traditionnelle, ce mouvement féministe radical a vite pris de l’ampleur.
C’est dans le contexte délétère de l’élection de Donald Trump, entre les envolées de JD Vance et de Elon Musk et les “Your Body, my choice” de Nick Fuentes que les femmes étatsuniennes se sont emparées du 4B. Dans une vidéo tiktok postée le 6 novembre, une jeune femme a annoncé sa décision de quitter son compagnon républicain et de rejoindre le mouvement 4B. En quelques jours à peine la vidéo a été vue plus de 1 millions de fois et le hashtag #4B est devenu immédiatement viral. En plus des 4 piliers, le 4B s’accompagne aussi d’une soustraction aux exigences hétérosexuelles comme le maquillage et les cheveux longs.
Parfois critiqué pour sa radicalité, le mouvement 4B est souvent vu comme une sécession un peu vaine, un rejet des hommes soit immature, soit violent. D’ailleurs, dans un article du 15 novembre 2024, le magazine Elle titrait “C’est quoi le 4B, ce mouvement féministe qui rejette les hommes.” La formulation n’est pas anodine, et si l’article dénonce la misogynie dont sont victimes les femmes en Corée et aux États-Unis, le soupçon est quand même là. Les hommes sont rejetés et rien de bon ne peut sortir de ça. L’appel à la nuance ne devrait pas tarder à suivre.
Déjà cette vision réductrice montre bien la pauvreté de nos imaginaires si l’on est pas capable de voir que ne pas coucher avec les hommes, ne pas se marier et ne pas porter d’enfant laisse la place à tout un tas d’autres activités : travailler avec un homme, être ami avec un homme, faire du sport avec un homme, déjeuner ou dîner avec un homme, monter une entreprise avec un homme et ainsi de suite…
Par ailleurs, dans un pays où le droit à l’avortement est remis en cause, mettant en péril la vie et la santé des femmes, la décision de ne pas coucher avec des hommes n’est pas seulement une punition injuste mais aussi le seul moyen pour les femmes, dans un premier temps, de lutter contre le recul de leurs droits. La radicalité de ce mouvement dépasse largement l’effet de mode, non seulement cette attitude est frappée au coin du bon sens mais elle s’enracine dans une tradition féministe qui a pris de nombreuses formes au gré des vagues successives de féminisme. Le 4B n’est donc pas une preuve de plus de la radicalité et de l’hystérie des féministes mais bien un moyen de pression politique et de désobéissance civile, au même titre que la grève du sexe et le séparatisme lesbien (le fameux lesbianisme politique).
Beaucoup utilisé en Afrique, la grève du sexe est un moyen de pression extrêmement efficace. En 2002, la grève du sexe menée par Leymah Gbowee au Liberia a permis de faire pression sur les négociations de paix. Même chose au Togo en 2012, où les femmes ont fait la grève du sexe pour demander le départ du président Faure Gnassinbé.
Développé dans les années 1960, le lesbianisme politique, popularisé par Monique Wittig et Adrienne Rich était un mouvement qui visait à sortir non seulement de la pression de l’hétérosexualité mais aussi de la nécessité pour les femmes d’éduquer les hommes, tâches ô combien chronophage et pas toujours suivi d’effet. Le séparatisme lesbien a beaucoup été critiqué, ne serait-ce qu’à cause des risques d’essentialisation, voire de fétichisation des lesbiennes. Lesquelles ne sont pas par définition forcément féministes.
Prise au pied de la lettre et par le prisme des réseaux sociaux, tous ces mouvements sont immédiatement dépolitisés et décrédibilisés. Il n’en reste pas moins que la détresse des femmes, et des étatsuniennes en particulier, dans des sociétés qui se radicalisent, sont évidentes et que tous les moyens sont bons pour se défendre et se protéger.
Et un fait demeure : quelle que soit la forme que cela peut prendre, il a toujours existé des femmes qui, par choix ou par hasard, dans la joie ou dans la tristesse, ont mené une vie solitaire, une vie hors du couple, une vie délestée des dettes et des contre-dettes. Une vie de célibataire, dit-on ? Et c’est aussi parce que ces vies ne sont jamais vraiment vues et valorisées que nous sommes parfois si démunies. Que se passerait-il si on donnait à la solitude féminine la place qui lui revient, dans la société et dans le combat féministe ?
L'écologie trans
Lors de son investiture le 20 janvier 2025, Donald Trump a déclaré : “À partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des Etats-Unis sera qu’il n’y a que deux sexes, masculin et féminin”. Tout au long de sa campagne, le nouveau Potus a attaqué les droits des LGBTQIA+ et surtout ceux des personnes trans ; son électorat en a fait une priorité. Cette haine a été attisée par un Elon Musk décomplexé, qui a pour arme le réseau social X (ex Twitter).
Alors que les théories transphobes se propagent aussi en Europe et en France, même chez certaines “feministes”, l'occasion de rappeler que la science démontre les infondés de cette offensive contre les genres.
Une personne trans est une personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Il est souvent pensé que les revendications, les définitions, la protection ou l’intégration tournent souvent autour des questions sociales et sociétales. Cependant, les féministes qui excluent les femmes trans des luttes féministes (TERF) s’appuient essentiellement sur la nature, la biologie et la reproduction pour valider leurs théories d’exclusion.
Le femmélisme ou “Femalism” a été popularisé dans le monde anglo-saxon par la féministe anglaise Posie Parker (Kellie Jay Keen). En France, ce mouvement est mis en lumière par des influenceuses dans un manifeste qui explique que “la femme est un être de nature et de culture, avec des traits de personnalité propres à chacune. Simplement, le corps est la seule chose qui permet de définir ce qu’est une femme. [...] Être une femme n’est ni un sentiment, ni un costume, ni une identité de genre.[...] Être une femme, c’est une réalité biologique qui se manifeste à travers un ensemble de caractères sexuels primaires et secondaires : chromosomes sexuels, gonades, hormones et anatomie générale.” Elles affirment également que “Chez les mammifères, changer de sexe est impossible”.
Pourtant, ce postulat opposant la composante naturelle à celle de la transidentité, est contrariée par plusieurs études biologiques, historiques et écologiques.
Tout d’abord, le monde animal, toujours aussi surprenant et en avance sur l’humain, nous dévoile des exemples. Thierry Lodé, chercheur en écologie évolutive et éthologie à l’université de Rennes révèle que “dans le monde animal, il n'y a pas de corps de mâle ou de corps de femelle. Chez beaucoup d'espèces, les sexes ne se distinguent pas par les gènes. Les crocodiles se sexualisent en fonction de la température d'incubation, les abeilles en fonction du nombre de chromosomes, etc. Même chez les mammifères, la testostérone, l'hormone mâle, est produite par des tissus sous le contrôle du chromosome X, en double exemplaire chez les femelles.” La question du genre ne peut donc se résumer à une histoire de programme génétique.
Thierry Lodé va même plus loin en affirmant que c'est lors du stade subadulte, soit l'équivalent d'une partie de l'enfance et de la première partie de l'adolescence, que le sexe se construit et s'accepte d'un point de vue genré. Cela ne colle pas toujours avec les organes que son ADN lui a donnés. “Certains singes n'acceptent pas d'être mâles et se considèrent comme étant des femelles. Parfois, ils sont même acceptés comme tels au sein de leur groupe social. Il en va de même pour des espèces plus éloignées de la nôtre, comme chez les mangoustes ou les goélands.”
Si on se tourne du côté de l’histoire, la préhistoire nous apporte son lot de surprises. En effet, d’après Doug VanderLaan, chercheur à l’université de Toronto sur les aspects identité de genre et du développement sexué, nous enseigne que les homo sapiens ancestraux reconnaissaient le troisième genre. “Dans certaines sociétés, ces individus s'identifiaient comme membres d'une troisième catégorie de genre : ils ne sont pas socialement reconnus comme étant des hommes ou des femmes, mais plutôt comme une troisième catégorie. Ce que montre une de ses études est surprenant. Les "mâles androphiles transgenres" étaient acceptés dans les cultures chasseurs-cueilleurs traditionnelles malgré leur orientation sexuelle et/ou leur identité sexuelle, ils restaient des individus présents pour soutenir et aider leurs familles. Tout simplement. En plus, en s'investissant dans leurs familles, ils s'assuraient que leur lignée survivrait jusqu'aux générations suivantes même si eux n'avaient pas d'enfant.” On retrouve cette acceptabilité dans l’antiquité, au moyen-âge, en Inde ou chez les Zoulous en Afrique du Sud.
Du côté de l’écologie, la lutte environnementale croise les luttes pour les droits LGBTQI+ et particulièrement trans. “Nature is queer!” se sont exclamées à l’unisson Beth Stephens et Annie Sprinkle, représentantes du mouvement écosexuel qu’iels ont fondé. “La nature est diverse, ne juge pas et ne définit pas ce qui est considéré contre-nature ou pas.” L’écosexualité est finalement une forme d’activisme environnemental, mouvement qui a la particularité de faire place aux LGBTQI+ qui ont longtemps laissé de côté la défense des problématiques environnementales, déjà occupés à revendiquer la reconnaissance de leurs propres droits. C’est le constat que fait également l’activiste climatique queer Cy Lecerf Maulpoix dans son livre “Écologies déviantes” où il étudie les convergences possibles entre combats LGBTQI et lutte environnementale. Lors de son engagement dans des évènements écologiques comme la COP21, Cy Lecerf se retrouve confronté à un monopole des hommes hétérosexuels sur la parole environnementale, qui craignent un “détournement des enjeux écologistes au profit de politiques minoritaires.” Il explique “qu’ en miroir, nombre de militants LGBTQI+ voient en l’écologie la “lutte de celleux qui n’auraient pas (…) d’autres oppressions contre lesquelles résister”, quand eux s’engagent sur des “urgences “concrètes” vécues”. Mais les LGBTQI sont de plus en plus visibles et engagé·es dans les luttes climatiques grâce à des stratégies héritées du militantisme d’Act Up, de l’“écoféminisme d’action directe” de Françoise d’Eaubonne. Iels veulent se mettre à distance une société vécue comme violente pour elleux et pour la nature en entrant en résistance. Dans plusieurs sociétés, des personnes dites "du 3e sexe" étaient réputées pour avoir une connexion particulière avec le sacré ou le vivant. “Dans le système capitaliste, la domestication, la préservation et l’exploitation de la “nature” va de pair avec la domination, l’exclusion ou la destruction des vies et des corps construits comme “mineurs” ou minoritaires : le corps des femmes, les corps racisés, les existences transpédégouines ou non-humaines.” ajoute l’auteur.
On peut affirmer que l'écologie est un vrai modèle de société à proposer qui permet à chacun de trouver sa place, notamment les personnes transgenres. Il est toujours important de rappeler que la lutte climatique est indissociable de la lutte antiraciste, anticapitaliste et pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI+. Il existe un lien indissociable entre l'acceptation et la tolérance de la transidentité dans une société d'une part, et l'altruisme et l'égalité entre les genres qui caractérise cette société d'autre part.
Syrie : “Affronter les choses vaut toujours mieux que les cacher”, interview exclusive de Lina Chawaf
En 2011, Bachar Al Assad déclarait au Wall Street Journal “ce qui s’est passé en Tunisie n’arrivera pas en Syrie”. Et pourtant, 14 ans plus tard, cela y ressemble. Le 8 décembre dernier, il était renversé après que les rebelles islamistes radicaux du HTC (Hay'at Tahrir al-Cham - branche d’Al Qaïda en Syrie, en relation avec Daech dans la région) ont lancé une offensive contre son régime. Il a fui en Russie, comme l’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali avait fui vers l’Arabie Saoudite (fuite dont il s’est défendu). Cette semaine, l'ancien président syriena fait l’objet d’un second mandat d'arrêt émis par des juges français, pour complicité de crime de guerre. Bilan chiffré : 24 ans de répression et plus de 500 000 personnes tuées.
Cette semaine, Clothilde Le Coz s’est entretenue avec Lina Chawaf, journaliste syrienne et directrice de Radio Rozana, qui émet depuis Paris vers la Syrie, la frontière turque et la Jordanie. Elle revient d’un voyage à Damas, 14 ans après l’avoir quitté et partage ses impressions, ses espoirs et son sens du combat.
Lire l’interview dans son intégralité ici
À voir
“Il suffit d’écouter les femmes”, INA/France 5
Cette phrase prononcée par Simone Veil en 1974 lors des débats à l’Assemblée nationale autour de la dépénalisation de l’avortement sert de point de départ d’un projet lancé en 2022 et en prévision des 50 ans de la loi Veil. Le but de cette initiative est de documenter le vécu de l’avortement à partir de 79 témoignages. Des femmes ayant participé ou vécu un avortement, des couples aussi, racontent leur expérience. Toutes générations confondues, ces témoignages sont bouleversants et rendent compte d’une partie fondamentale de la vie des femmes, de l’histoire de leurs corps.
Ces entretiens sont en accès libre sur le site de l’INA et font aussi l’objet d’un documentaire à voir en replay sur France 5.
À lire
“Il n'a jamais été trop tard”, Lola Lafon, Stock
“Ce livre est une histoire en cours. Celle d'un hier si proche et d'un demain qui tremble un peu. Ce présent qui bouscule, malmène, comment l'habiter, dans quel sens s'en saisir ? Comme il est étroit, cet interstice-là, entre hier et demain, dans lequel l'actualité nous regarde. Elle reflète le monde, mais aussi des évènements minuscules en nous, des souvenirs, des questions, des inquiétudes. Ces pages ne sont pas le lieu d'un territoire conquis, d'un terrain marqué de certitudes. Ce livre est l'histoire de ce qui nous traverse, une histoire qu'on conjuguerait à tous les singuliers”. *
* Description de l’autrice.
Bobigny 1972, Marie Bardiaux-Vaïente et Carole Maurel, Glénat
Un livre qui revient brillamment sur le procès qui a marqué le début des années 1970 en France. À travers les voix des différentes protagonistes (Marie-Claire Chevalier, Gisèle Halimi, Delphine Seyrig, etc.) on se plonge dans contexte politique, social et culturel de l’époque. Cet ouvrage met à l’honneur les combats des militantes qui ont oeuvré pour la dépénalisation de l’avortement. Le tout merveilleusement bien illustré par Carole Maurel.