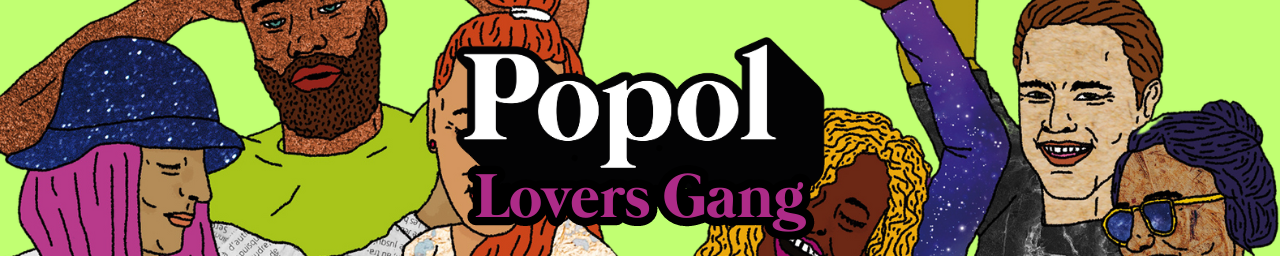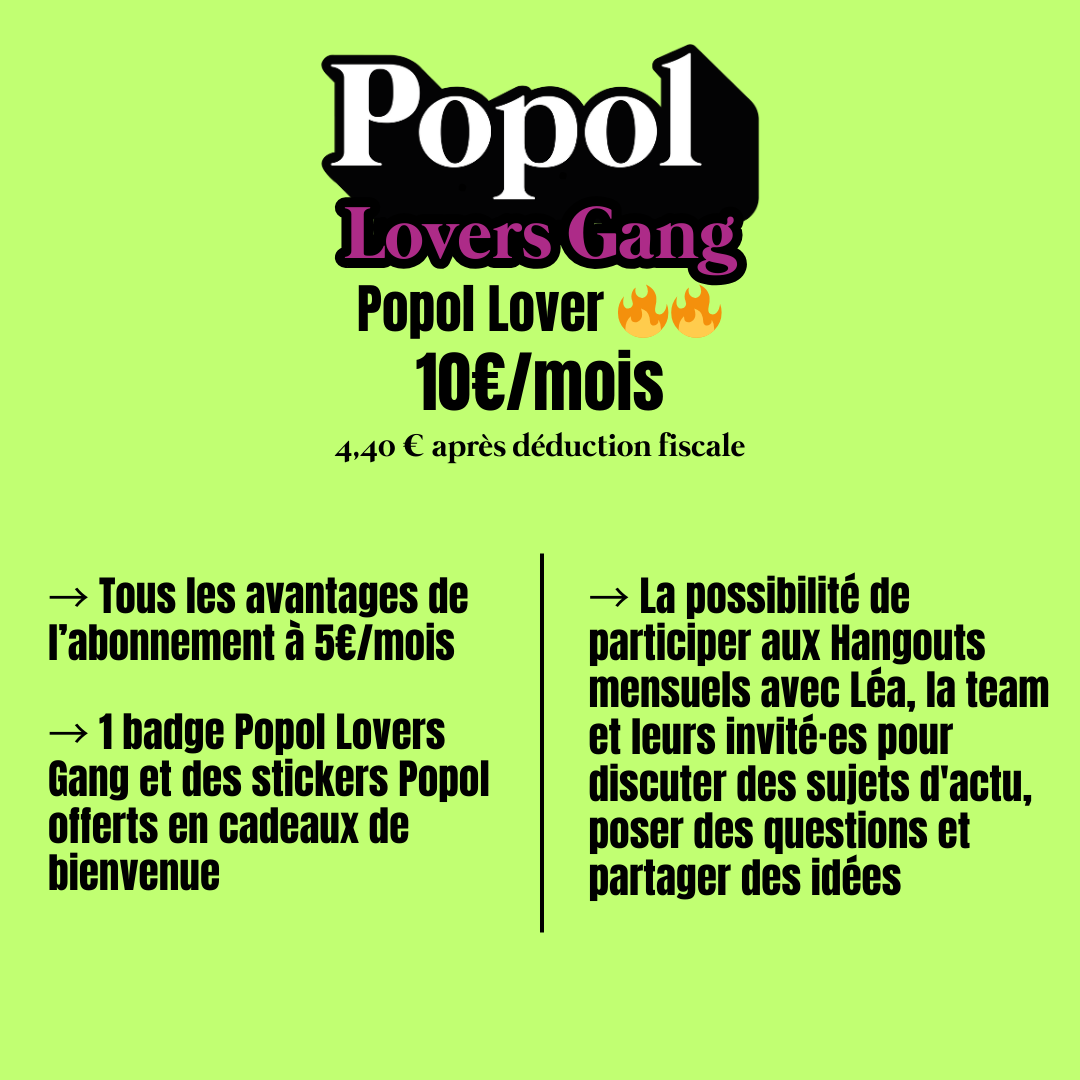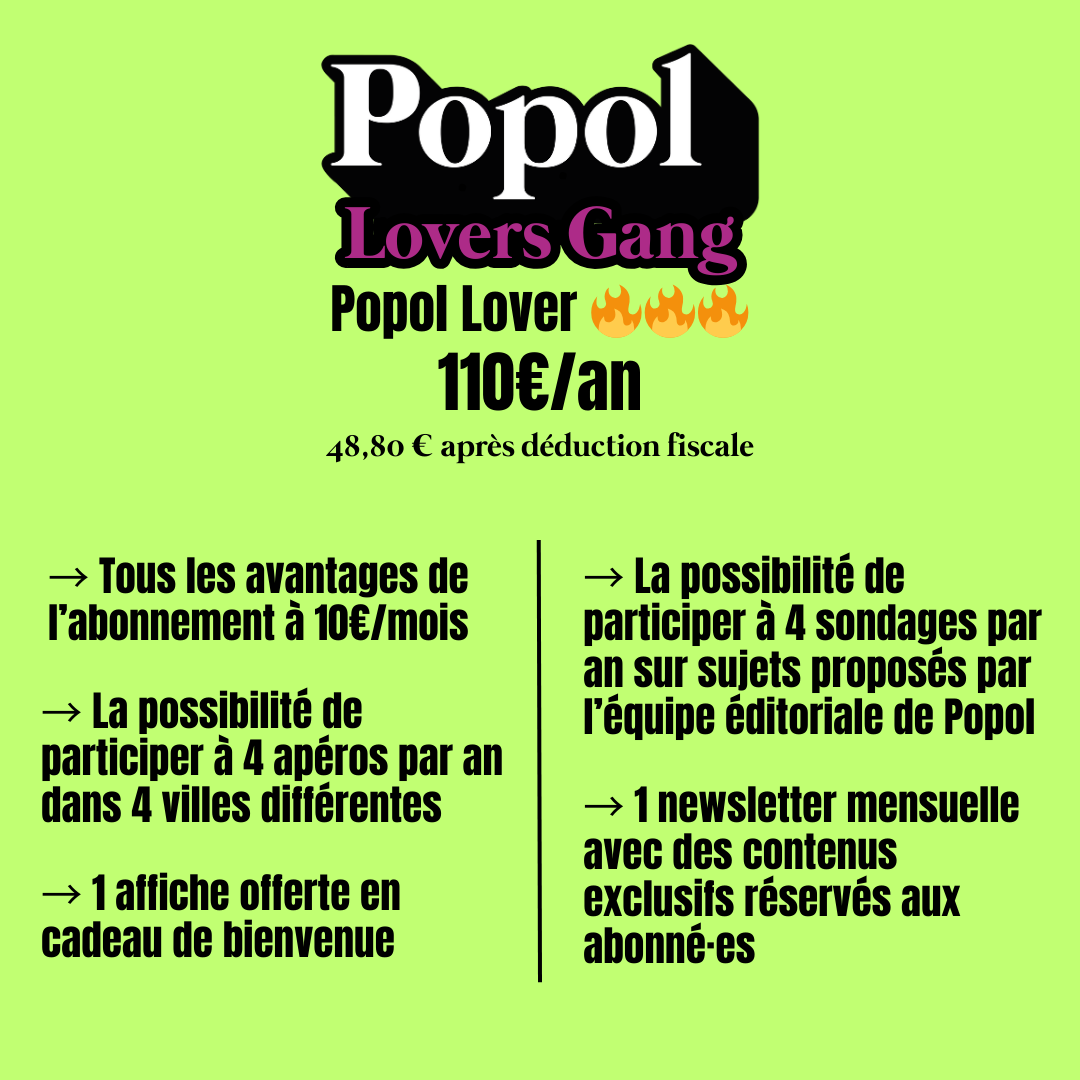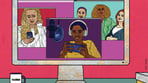Popol Post
La police, une institution façonnée par la domination et l'impunité


VSS dans la police : anatomie d’une institution hors contrôle
Quand les auteurs potentiels portent l’uniforme, le rapport d’autorité se démultiplie. Qui ose porter plainte contre celui qui est censé l’enregistrer, qui détient une arme, qui connaît la procédure, et parfois, sait l’utiliser contre vous ? Or, si l’institution policière veut être crédible dans la lutte contre les violences, elle doit d’abord regarder celles qui se produisent en son sein.
L’affaire du dépôt du tribunal de Bobigny a remis le sujet au centre du débat. Deux policiers ont été mis en examen et écroués pour “viol et agression sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions” sur une femme de 26 ans, privée de liberté dans une cellule. La procureure de Paris, Laure Beccuau, a indiqué que les déclarations de la plaignante sont corroborées par des éléments du dossier, et rappelé ce principe simple mais essentiel : peut-on seulement parler de “consentement” quand la femme est retenue au dépôt, donc sous contrainte ? Une courte vidéo a d’ailleurs été retrouvée sur le téléphone de l’un des policiers, les deux agents ont été suspendus. Ce sont des mots nets, posés par la justice, et ils disent bien l’enjeu : c’est l’abus d’autorité qui est au cœur du dossier.
Cette affaire réactive aussi un souvenir d’une autre que l’oublie pas, celle du “viol au 36”. En 2019, deux policiers de la BRI ont été condamnés en première instance pour le viol d’Emily Spanton dans les locaux du 36, quai des Orfèvres, puis acquittés en appel en 2022. Douze avocates et juristes ont alors sollicité un pourvoi en cassation “dans l’intérêt de la loi”, non pour rejuger les faits, mais pour dénoncer un arrêt qu’elles estiment “empreint de préjugés” : la vie privée de la plaignante disséquée, l’alcool retenu contre elle au lieu d’être considéré comme facteur de vulnérabilité, la méconnaissance du stress post-traumatique, une vision irréaliste du viol (comme s’il devait forcément s’accompagner de brutalités visibles et d’un récit parfaitement linéaire). Mediapart, dans un article intitulé : “Viol au 36 quai des Orfèvres : ces stéréotypes qui imprègnent le verdict d’acquittement”, signé Lénaïg Bredoux et Marine Turchi, revient sur les stéréotypes à l’œuvre dans la décision. Le pourvoi a été refusé, l’acquittement est devenu définitif. Et l’arrêt dit quelque chose de la façon dont des stéréotypes de genre peuvent infuser jusqu’au jugement d’accusations visant des policiers.
Au-delà de ces cas médiatisés, une enquête de Disclose met en lumière une réalité systémique : 429 victimes identifiées entre 2012 et 2025 et 215 policiers ou gendarmes mis en cause pour harcèlement, agressions sexuelles ou viols ; 40 % d’entre eux sont multirécidivistes. Ces violences visent des plaignantes venues déposer, des personnes en garde à vue, des mineur·es, des travailleuses du sexe, des personnes exilées ; elles s’appuient souvent sur l’abus de moyens policiers, fichiers internes pour récupérer des coordonnées, usage du véhicule ou de l’arme, perquisitions simulées. Disclose souligne aussi une faille réglementaire et disciplinaire : l’absence de directive claire interdisant explicitement toute relation sexuelle avec une personne détenue ou une plaignante, peu de transparence, et des sanctions faibles (18 policiers sanctionnés pour violences sexuelles depuis 2021, alors que certains auteurs restent en poste malgré des condamnations). Voilà la mécanique ordinaire de l’impunité.
Face au choc de Bobigny, une mesure a été avancée : imposer la présence d’une policière dans l’équipe de nuit au dépôt. Intention louable, mais réponse insuffisante. Comme l’écrit Johanna Luyssen dans un billet de Libération, on déplace sur une femme la responsabilité d’empêcher ce que des hommes commettent, alors que le problème est structurel. Et les violences ne se concentrent ni dans un seul lieu ni sur un seul créneau : elles se produisent aussi en patrouille, en contrôle routier, dans les commissariats. La féminisation des effectifs est indispensable ; elle ne saurait être une solution symbolique pour répondre à des problèmes structurels et à une défaillance du système.
Regarder à l’étranger aide à nommer ce qui fait défaut ici. Au Royaume-Uni, un rapport publié en 2023 a conclu à une misogynie et un racisme institutionnels dans la Metropolitan Police, avec des recommandations ambitieuses : procédures disciplinaires refondues, “nettoyage” des effectifs, contrôle externe renforcé, etc. Dans la foulée, une “super-plainte” du Centre for Women’s Justice a obligé les autorités à reconnaître un traitement défaillant des violences conjugales commises par des policiers, à imposer des circuits d’enquête indépendants et à mieux protéger les victimes, y compris quand elles travaillent dans la même force. Ce n’est pas parfait, mais c’est une boussole : les chaînes hiérarchiques locales ne doivent pas instruire ce qui concerne leurs propres collègues ; la traçabilité disciplinaire est essentielle ; la formation et l’évaluation doivent être obligatoires et continues.
Les normes internationales, elles, ne laissent place à aucune ambiguïté. La Convention d’Istanbul impose que le consentement soit libre et éclairé, et “considéré dans le contexte des circonstances environnantes”. Autrement dit, on ne peut abstraire une relation sexuelle de la contrainte d’une garde à vue, de l’ivresse, de la peur, ou d’un rapport d’autorité. C’est une évidence juridique qui n’est toujours pas pleinement intégrée dans les pratiques, ni dans les textes déontologiques du ministère de l’Intérieur.
Que faire, concrètement ? D’abord, nommer l’abus d’autorité pour ce qu’il est et l’encadrer en droit. Pour ce faire, une règle claire doit interdire tout rapport sexuel entre un policier et une personne privée de liberté, gardée à vue, déférée ou venue déposer plainte, avec des conséquences automatiques et cumulatives, à la fois disciplinaires et pénales. Ensuite, sortir ces dossiers de la proximité hiérarchique : procédures d’enquête indépendantes de la chaîne locale, contrôle du parquet, retrait immédiat d’arme et interdiction de contact, etc. En parallèle, former massivement et évaluer la formation sur le consentement, les traumatismes, les VSS, les stéréotypes (alcool, tenue, vie privée), la prise de plaintes, etc. Certaines formations sont ont été mises en place, mais elles sont insuffisantes.
Or, rien de tout cela ne tiendra si l’on continue à juger au prisme de stéréotypes et si l’on persiste à confondre hiérarchie et protection corporatiste. L’affaire du 36 a mis en évidence les biais persistants et celle de Bobigny rappelle qu’en détention, le consentement n’existe pas. Et pendant ce temps, des femmes continuent de déposer leur plainte… devant des hommes parfois condamnés pour violences conjugales.
La question, en réalité, n’est pas de savoir si la majorité des policiers est irréprochable. Mais il s’agit de savoir ce qui arrive quand certains ne le sont pas, et que l’institution les couvre. Certains exemples à l’étranger montrent que l’on peut changer la donne avec une véritable volonté politique, ce qui ne risque pas d’arriver chez nous lorsque l’on sait que notre ministre de la Justice - anciennement ministre de l’Intérieur - a lui-même était mis en cause dans une affaire de violences. La confiance dans les institutions ne se décrète pas, elle se construit. Et dans ce domaine, l’État a des comptes à rendre, à commencer auprès de celles qu’il n’a pas protégées.
Les premières femmes flics
Connaissez-vous Simone Monvert et Berthe Rolland ? Ces deux femmes sont des pionnières puisqu’elles ont constitué, en 1935, la première brigade féminine d’assistantes de police. Dans une vidéo de Gaumont Actualité datant du 19 avril 1935, ont voit les deux femmes saluer le préfet de Police et une voix qui nous explique « Le féminisme remporte une victoire ! Si les femmes n’ont pas pu pénétrer le parlement, elles ont conquis la préfecture de police. » Et ce fait, la création de cette toute première brigade féminine est le résultat d’une longue lutte menée depuis une vingtaine d’années par le Conseil national des femmes françaises, une association suffragiste créée en 1901 et d’inspiration protestante. Cette association a milité auprès du conseil de Paris avec l’aide des conseillers municipaux issus de la droite modérée. Le faible investissement de la gauche et notamment des femmes communistes est liée à une profonde méfiance de ces dernières à l’endroit d’une institution qui les harcèle. On peut donc comprendre leur frilosité à l’idée de faire de la féminisation de la police un combat féministe.
Issues du corps des assistantes sociales, mis en place dans les années 20, le rôle de cette première brigade féminine était plus préventif que répressif. Chargée de veiller à la protection de l’enfance, elle faisait des rondes autour des écoles et des jardins, prévenait le vagabondage scolaire (i.e. l’école buissonnière) et veillait à la sécurité des femmes. A l’instar des assistantes sociales, ce sont elles qui pénétraient, sans armes, dans les foyer violents pour en évaluer les problématiques et envisager des solutions. Non armées, Simone Monvert et Berthe Roland avaient toutefois le pouvoir d’arrestation et de donner des amendes. Elles étaient reconnaissables à leur grand manteau « bleu préfecture » qu’elles portaient par-dessus un tailleur pantalon bleu préfecture. Leur uniforme était parachevé par un chapeau de feutre à l’insigne de la ville de Paris.
Fin 1938, les femmes étaient 5 dans la fameuse brigade, Jeanne Begou, Odile Rieder et Huguette Laurent ayant rejoint Simone Monvert et Berthe Roland. La féminisation de la police a poursuivi sa lente évolution, la lutte pour l’égalité salariale ayant remplacé les seules revendications purement féministes (féminisation professionnelle et protection des citoyennes). En 1974, les femmes sont admises au concours d’inspecteur de police et en 1984 à celui des Officiers de la paix. Cette féminisation n’a jamais été souhaitée par l’institution et a toujours été imposée « d’en haut », comme on dit, par des choix politiques de ministres et même de présidents de la République (c’est à Giscard d’Estaing que les femmes doivent leur admission au concours de commissaires en 1974). A noter aussi que la police est une des rares institutions où l’hégémonie masculine n’a jamais été vraiment menacée, malgré une féminisation en constante croissante. Les quotas, officiels entre 1935 et 1992, sont devenus officieux et l’on joue sur les questions de morphologie et sur les épreuves sportives pour s’assurer que jamais les femmes ne puissent menacer l’accession des hommes à quelques postes que ce soit. L’image de la femme flic, exceptionnelle en 1935, est maintenant devenue une figure plus ordinaire, comme en témoigne la pop culture et notamment les séries télévisuelles qui mettent en scène des personnages de policière à tous les échelons possibles.
Simone Monvert, première femme flic, a documenté son travail dans un journal dont on peut lire quelques pages au musée Carnavalet. L’accession de ces femmes à l’époque avait fait grand bruit, et avait, au-delà de l’évènement et des critiques, soulevé une vague d’espoir, celle d’une ville aux rues plus sûres pour les femmes et les enfants… Cet idéal, en même temps que l’esprit de résistance de l’après-guerre, s’est perdu dans une philosophie du maintien de l’ordre répressive et meurtrière. Se rappeler l’histoire de Simone et Berthe n’est pas seulement rendre hommage à des pionnières et saluer le féminisme mais se rappeler de ce qui aurait pu advenir et fournir une base de réflexion pour la suite, car au milieu du chaos, une pensée rassurante : ce qui a déjà existé peut encore revenir.
Ceci n’est pas du terrorisme
Avant d’en arriver à des actions considérées comme du sabotage, il y a eu des centaines de marches climatiques pacifistes dans le monde inspirées par Greta Thunberg. Celles-ci sont restées lettre morte auprès des gouvernements. Pire, les protestations à Sainte-Soline en 2023 ont été considérés comme de l’”éco-terrorisme”.
La désobéissance civile environnementale s’inscrit dans une longue histoire. Pourtant, on peut fixer la naissance de l’écoterrorisme vers le milieu des années 1960 en Angleterre, avec des groupes activistes opposés à la chasse. Le groupe le plus connu est probablement le Hunt Saboteurs Association (HSA) fondé par John Prestige à Brixham en Angleterre. Ce groupe avait essentiellement pour objectif de nuire aux chasseurs en utilisant des sifflets pour faire fuir les animaux, laissant de fausses pistes, installant des clôtures, etc. Tout cela, dans l’objectif de nuire aux chasseurs.
En France, de 1971 à 1981, l’extension d’un camp militaire sur le causse du Larzac fut à l’origine d’un énorme mouvement de désobéissance civile non violente. Entre 60 000 et 100 000 personnes de différents courants convergèrent vers le Larzac pour soutenir les paysan·e·s et former un mouvement hétéroclite. Plusieurs actions seront retenues durant cette décennie de lutte comme les 22 militant·e·s et paysan·e·s qui se sont infiltré·e·s dans le camp militaire pour y détruire 500 dossiers relatifs à l'enquête parcellaire avant expropriation. Ou encore, en riposte à la signature des arrêtés d’expropriation des terrains, 150 tracteurs agricoles et 5000 personnes vont labourer les terrains de l’armée. José Bové s’inspira du Larzac 10 plus tard lorsqu’il lança des fauchages de champs de maïs OGM, détruisit des stocks de semences génétiquement modifiées ou encore pris part au démontage d’un Mac Donald, symbole de la malbouffe et du capitalisme.
Le Larzac sera aussi un symbole féministe lorsque le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la cotraception (MLAC) prit part à la résitance en 1974. Le liberté sexuelle s’installe sur le plateau. Cette convergence fut un des premiers pas de la démonstration que les luttes environnementales et féministes sont communes. L’écoféminisme fera son émergence.
Françoise d’Eaubonne fut une des pionnières de l’écoféminisme, mais aussi de la désobéissance civile environnementale. En 1975, elle a participé au dynamitage de la pompe du circuit hydraulique de la centrale de Fessenheim, en Alsace, alors en construction, retardant ainsi de plusieurs mois sa mise en route. Bien que l’action ait alors été anonyme, le texte de revendication rappelait « que les femmes sont à l’avant-garde du refus du nucléaire qui n’est autre que le dernier mot de cette société bâtie sans elles et contre elles ». Elle fut également une des manifestantes les plus actives contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure.On peut inclure dans ce mouvement écoféministe, la "justice environnementale".
Comme pour les luttes environnementales, les luttes féministes furent à la pointe de la désobéissance civile. Si on remonte à l’époque de la lutte pour le droit de vote des femmes, les militantes désignées sous le nom de « suffragettes », optèrent pour de nouvelles formes d’action, parfois violentes et illégales (incendies volontaires, bris de vitre, grèves de la faim, etc.). Presque 100 ans plus tard, les Femens ou les colleuses seront aussi considérées comme des militantes féministes radicales…
Aujourd’hui, cette supposée radicalisation environnementale se crispe autour d’Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation. Le sitting à Sainte Soline a été la goutte d’eau pour la classe politique de droite. Avant d’en arriver à des actions considérées comme du sabotage, il y a eu des centaines de marches climatiques pacifistes dans le monde inspirées par Greta Thunberg. Celles-ci sont restées lettre morte auprès des gouvernements. Alors, puisqu’il y a situation d’urgence, notamment lorsque l’on aborde la question des changements climatiques, il est donc nécessaire de procéder à des actions drastiques pour changer les pratiques environnementales actuelles. Mais on reste bien loin des actions citées précédemment. Des vitres d'œuvres d’art reçoivent de la soupe, des banderoles sont accrochées sur les devantures des grandes entreprises pétrolières, des mains sont collées sur des périphériques ou encore un menottage à un filet de tennis lors du dernier Roland Garros. Le but de ces organisations restent plus de l’ordre d’attirer l’attention plutôt que d’utiliser la violence.
L’écoterrorisme exploite généralement des techniques visant principalement à détruire des biens. Il n’y a jamais eu de victimes humaines, comme pour les actions féministes. À l’inverse, on ne peut pas en dire autant de la répression des activistes. Rémi Fraisse, botaniste de 21 ans, succomba à l'explosion d'une grenade tirée par un gendarme lorsqu’il s’opposait au barrage de Sivens, est la parfaite illustration. Tout comme les récentes révélations de Médiapart et Libération, dévoilant les vidéos des forces de l’ordre à Sainte Soline provoquent l’effroi. Ces images montrent des gendarmes voulant “tuer” ou estropier des militantes écologistes, avec des méthodes reconnues violentes et dangereuses.
À lire
“Silence, on cogne. Enquête sur les violences conjugales subies par des femmes de gendarmes et de policiers”, Sophie Boutboul, Alizé Bernard, Grasset, 2019
Alizé Bernard a été victime de violences conjugales. Si elle savait les difficultés qu’ont les femmes à parler et à se faire entendre, elle n’imaginait pas combien le statut de son conjoint rendrait son combat pour s’en sortir plus difficile encore. Car ce dernier était gendarme. Or comment faire quand celui qui vous bat se sert de son statut, représentant de l’ordre, de sa place dans l’institution policière, de sa connaissance des procédures et des liens supposés de solidarité avec ses collègues, pour vous intimider, vous dissuader de vous défendre et faire valoir vos droits ? A Sophie Boutboul, journaliste travaillant sur les violences faites aux femmes, elle a accepté de raconter son histoire ; les mois de silence, isolée en caserne, persuadée que nul n’accepterait de la croire, la peur démultipliée devant un homme incarnant la loi et disposant d’une arme de service, puis les années de luttes, seule, pour faire valoir ses droits malgré les obstacles qu’elle dénonce ; les tentatives de dissuasion de certains gendarmes, les procédures non respectées, l’absence de sanction hiérarchique, l’indulgence de certains juges. L’impr ex ession de se battre contre un système. (Description de la maison d’édition).
“Défaire la police”, ouvrage collectif (Elsa Dorlin, Jérôme Baschet, Serge Quadruppani, le Collectif Matsuda, Irene et Guy Lerouge), Divergences, 2021
“Faut-il en finir avec la police ?” La question se pose avec une nouvelle intensité depuis le mouvement mondial déclenché par la mort de George Floyd aux États-Unis. Alors que les violences policières sont de plus en plus visibles, l’image du gardien de la paix et l’idée que la police serait un service public tendent à s’effriter. Il est maintenant entendu que l’institution policière est la garante d’un certain ordre, d’un certain régime de domination. Dans le contexte de défiance et de surenchère qui est le nôtre, il paraît moins pertinent de réfléchir à une énième réforme que de se demander comment résoudre nos conflits sans elle, comment la neutraliser, la priver de sa légitimité et de ses moyens. (Description de la maison d’édition).
À écouter
Gardiens de la paix, Ilham Maad, Arte Radio, 2020
Membre d'une unité de police d’escorte à Rouen, Alex découvre l'existence d'un groupe privé d’échanges audio sur WhatsApp, dont font partie une dizaine de ses co-équipiers. Certains sont encore stagiaires en école de police, d'autres, comme lui, sont policiers titulaires depuis plus de 20 ans. Intrigué par la présence de son prénom dans les messages, Alex, qui est noir, découvre des propos orduriers, ouvertement racistes, misogynes et antisémites. Certains de ses collègues se revendiquent du fascisme et du suprémacisme blanc. Dans leurs échanges, ces soi-disant "gardiens de la paix" se vantent d'acheter des armes en prévision de la "guerre civile et raciale" qu'ils appellent de leurs vœux. Sur les conseils de son avocate, M° Yaël Godefroy, Alex dépose plainte et déclenche une enquête interne. Après son audition, la hiérarchie décide de muter Alex dans une autre unité. Ses collègues titulaires ont finalement été révoqués.
À voir
“Violences policières, le combat des familles”, documentaire de Inès Belgacem, disponible sur France TV replay
Dans ce documentaire, la journaliste Inès Belgacem, donne la parole à celles et ceux qui ont perdu un frère, un mari, un fils, victime de violences policières. Iels racontent les circonstances de la mort de leur proche, mais aussi leur difficile combat ensuite pour obtenir justice et parfois aussi pour connaître la vérité. Un documentaire nécessaire, qui met des faits et des visages, sur une réalité que l’on peine trop souvent à appréhender.
À faire
Popol en Live avec David Dufresne, 8 décembre 2025, Point Ephémère
Popol Talk en live avec David Dufresne au Point Éphémère (Paris 10e), le 8 décembre à 19h. Léa Chamboncel échangera avec lui sur son parcours engagé, son travail journalistique et son dernier livre Remember Fessenheim. La rencontre sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Un livre, une tasse de thé !
Réservez vite vos places ici !